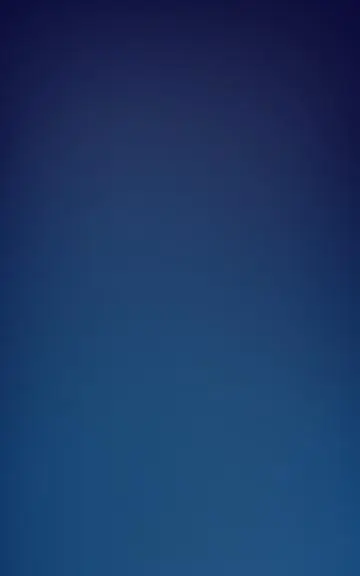À l’occasion de la toute récente parution de la traduction française de la Sprachtheorie de Bühler (1934) – la Théorie du langage. La fonction représentationnelle, éditée par Janette Friedrich et Didier Samain, Agone, janvier 2009 [1] –, la chaire de philosophie du langage et de la connaissance du Collège de France (Pr Jacques Bouveresse) et l’UMR 7597 d’Histoire des Théories Linguistiques (HTL) du CNRS et de l’Université Paris-Diderot organisent les 29 et 30 avril au Collège de France, à Paris, un colloque intitulé : Karl Bühler, penseur du langage. Linguistique, psychologie et philosophie.
Née à un moment où la psychologie se constituait en discipline autonome, tout en restant nourrie par la réflexion philosophique, l’œuvre de Bühler occupe, pour l’histoire contemporaine des sciences du langage, une position privilégiée, traversée de surcroît par les divers questionnements de l’époque. On a souvent mentionné sa relation critique à Wundt puis à la Gestalt, à la phénoménologie husserlienne et au Cercle de Vienne, et, du côté des linguistes, à la phonologie naissante. Ce ne sont là du reste que les interférences les plus notoires. En linguistique, l’œuvre doit sans doute autant à Paul et Brugmann qu’à Troubetzkoy, et la remarque vaut mutatis mutandis pour les autres champs disciplinaires. L’originalité du médecin et philosophe de formation qu’était Bühler aura notamment tenu au dialogue qu’il a constamment mené avec les grands linguistes de son temps, sans être à proprement parler « linguiste » lui-même.
Longtemps ignoré en France, Bühler y bénéficie désormais d’un réel intérêt. Dans ces conditions, la parution prochaine d’une traduction française de son œuvre majeure, la Sprachtheorie, dont ce sera de surcroît la première édition critique, comblera une réelle lacune dans les publications francophones. Toutefois, tout comme le reste de l’œuvre, l’accès à ce texte et la compréhension de ses enjeux n’en restent pas moins délicats. C’est ainsi, pour ne citer que cet exemple immédiat, qu’on crédite généralement Bühler, à juste titre, de la thèse que le langage ne se limite pas à sa fonction cognitive, puisqu’il possède aussi une fonction « d’appel » et une fonction « d’expression ». Or c’est pourtant bel et bien la fonction représentationnelle que l’auteur mentionne en sous-titre de la Sprachtheorie, en lui conférant donc d’office un statut privilégié. Parce qu’elle était en relation avec l’ensemble du savoir linguistique, psychologique et philosophique d’une époque particulièrement féconde pour les sciences humaines, l’œuvre de Bühler engageait une réflexion générale sur le rapport entre langage et cognition, et entre sciences du langage et disciplines connexes. Elle invite aussi, et peut-être plus fondamentalement, le linguiste et le philosophe d’aujourd’hui à réfléchir sur nombre de notions (langue, phrase, etc.) qui constituent leur métalangage ordinaire.
1] Préfacée par Jacques Bouveresse, cette édition inclut une présentation de l’œuvre par Janette Friedrich, le texte traduit par Didier Samain, un appareil de notes et un important glossaire