Colloque coorganisé avec le CAREP (Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris).
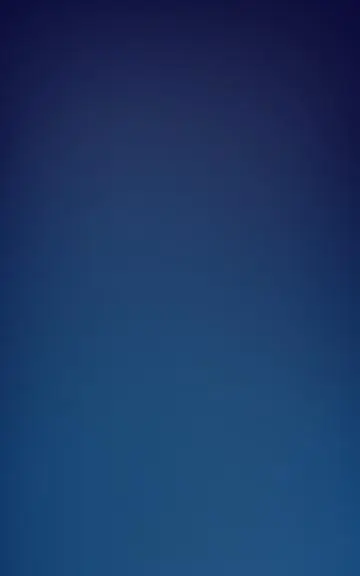
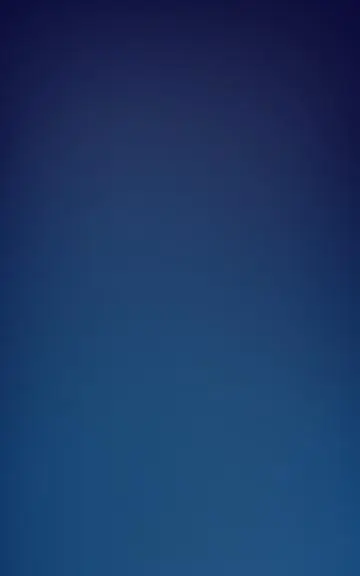
Colloque coorganisé avec le CAREP (Centre arabe de recherche et d'études politiques de Paris).
Depuis la fin du XVIIIe siècle, si on prend en compte le voyage en Égypte et en Syrie de Volney, les sciences humaines et sociales (SHS) en Occident s’intéressent au monde arabe. On trouve différentes approches que l’on peut définir soit comme une vérification sur le terrain d’hypothèses théoriques, soit au contraire la formulation d’hypothèses théoriques à partir de l’enquête de terrain. Ces approches comportent chacune des risques : plaquer des réalités autres sur ces sociétés d’une part, adopter sans perspective critique le discours de ces sociétés sur elles-mêmes d’autre part. Ces biais ont notamment pu être contournés par le développement d’approches comparatistes entre plusieurs sociétés, y compris européennes.
Les révolutions arabes de 2011 ont conduit à une réévaluation de ces différentes approches dans la mesure même où elles n’ont pas permis une prédiction de ces mouvements et n’ont pu en donner une intelligibilité immédiate (Bennani-Chraïbi et Fillieule, 2012).
Par ailleurs, peu de chercheurs européens se sont penchés sur l’impact de ces soulèvements pour les SHS arabes (Catusse, Signoles et Siino, 2015). En revanche, du côté des acteurs concernés, les soulèvements de 2011 ont fait émerger des analyses ancrées dans les réalités du terrain et redonné la voix aux chercheurs arabes dans la production de récits sur leurs propres sociétés (Bayat, 2021).
Dans ce contexte, penser les SHS dans les mondes arabes c’est d’abord penser les transferts de compétences entre un savoir né en Occident et sa production sur le terrain. S’y ajoute la difficile question des rapports entre les régimes autoritaires et la production du savoir. D’autant que parallèlement l’Etat est lui-même devenu producteur d’informations statistiques indispensables pour sa gestion et a eu besoin d’interprétations de ces données. Les SHS arabes se sont donc trouvées prises en étau entre les modèles théoriques largement empruntés à l’extérieur (qui diffèrent d’ailleurs selon leurs milieux de provenance) et les contrôles étatiques cherchant à limiter le rôle des SHS à une simple exploitation technique et politique des données statistiques.
Peut-on alors parler de « SHS arabes » comme étant une entité à part entière ? En effet, la production des idées et des savoirs en SHS dans les pays arabes est très variable d’un pays à l’autre. Ainsi, dans les pays du Golfe, l’héritage anglo-saxon est très marqué, tandis qu’il emprunte plutôt à la conception française des SHS dans les pays du Maghreb (El Kenz, 2006). Il en résulte un paysage de recherche fragmenté, non seulement déconnecté des préoccupations sociétales, mais aussi de l'université, lieu emblématique de production du savoir en SHS. D’autres lieux de production des connaissances moins liés aux instances étatiques, tels que des think tanks ou des associations savantes, se sont imposés dans le paysage depuis au moins deux décennies. Ainsi, au Machrek les bailleurs de fonds privés jouent un rôle majeur dans le financement des SHS, favorisant l’émergence des consultants-experts plutôt que le développement d’une recherche fondamentale.
Cette tendance au financement privé de la recherche s’est accélérée à la suite des événements du 11 septembre 2001, avec l’idée selon laquelle les sciences sociales devraient être politiquement « utiles ». Après l’échec des tentatives américaines de démocratiser « de l’extérieur » d’abord l’Afghanistan puis l’Irak, on constate une volonté grandissante des bailleurs de fonds et des fondations étrangères de financer des formations en SHS dans les pays arabes visant à former une « société de connaissance » (UNDP, 2003). C’est ainsi qu’il faut entendre l’émergence en 2006 du Conseil Arabe pour les Sciences Sociales (CASS) à Beyrouth, financé par la Fondation Ford et l’International Development Research Center du Canada.
Parallèlement, des initiatives financées et dirigées exclusivement par des acteurs arabes ont également vu le jour, comme en témoigne la création du Centre arabe de recherche et d'études politiques à Doha en 2010, ouvrant la voie à de nouveaux réseaux universitaires. Ces derniers sont de plus en plus structurés autour de « communautés » transnationales de chercheurs. Si l’analyse des circuits de financement fragilise une lecture strictement Nord-Sud ; elle met également en exergue la reproduction d’inégalités structurelles voire l'émergence de nouvelles dissymétries entre chercheurs locaux et chercheurs internationaux. Cette redéfinition des conditions de production des SHS implique aussi la nécessité, pour le chercheur, de s’approprier des cadres normatifs et principes « éthiques » uniformisés freinant la créativité et la liberté académique.
Penser les SHS dans les mondes arabes nécessite également de réfléchir à la réception de notions forgées en Occident et transférées en contexte arabe. À cet égard, l’exemple des gender studies donne à voir l’étendue des appropriations-réappropriations de la pensée féministe à l’échelle locale. Certains chercheur-es reprennent ainsi à leur compte ces idées venues d’Occident ; ils/elles s’en font même souvent les porte-voix. D’autres encore privilégient une utilisation située de ces concepts (Mahmood, 2005).
La réception de ces paradigmes en terrain arabe dépend également de la langue dans laquelle le savoir est produit, car derrière le langage se cachent toujours des enjeux de pouvoir et de domination (Bourdieu, 2014). La diversité des langues des SHS dans le monde arabe introduit un questionnement sur les « querelles linguistiques » au sein de la communauté scientifique allant jusqu'à provoquer des divergences terminologiques et conceptuelles. C’est pourquoi l’achèvement de l’arabisation dans l’enseignement supérieur et la recherche demeure au centre des préoccupations pour favoriser l’unité des « SHS arabes » d’une part et leur diffusion à l’international d’autre part. Car, plus l’arabe s'impose comme une langue de recherche, mieux sa traduction et sa diffusion se porteront (Jacquemond, 2007).
À l’heure de la mondialisation et le développement des technologies d’information et de communication, la diffusion des SHS arabes doit, elle aussi, composer avec le tout numérique. L’arrivée des bases de données en ligne est d’autant plus importante à étudier puisqu'elles ont pour vocation de démocratiser l’accès au savoir. Même si de nouvelles bases de données arabes ont vu le jour ces dernières années, les productions en langue arabe restent peu représentées dans celles fréquemment utilisées en Occident.
Mais ces évolutions technologiques de la recherche ne doivent pas nous faire perdre de vue que la circulation des connaissances passe encore et malgré tout par l’accès aux bibliothèques, aux archives, aux lieux de discussions et d’échanges scientifiques qu’il s’agit de développer et d’encourager à travers des mobilités d’étudiants et de chercheurs, mais aussi des coopérations scientifiques entre institutions de recherche.
Au-delà de ces questionnements, l’intérêt de ce colloque est bien évidemment de souligner l’importance des SHS dans la construction et la connaissance des mondes arabes et les rapports complexes qu’ils entretiennent avec l’Autre, en particulier l’Occident.
ASSAYAG Jacky et BENEÏ Véronique (dir.), « Intellectuels en diaspora et théories nomades », L’homme, revue française d’anthropologie, édition de l’EHESS, 156, Oct.-Déc. 2000.
BAYAT Asef, Revolutionary Life. The Everyday of the Arab Spring, Cambridge, Harvard University Press, 2021.
BENNANI-CHRAÏBI Mounia et FILLIEULE Olivier (dir.), « Retour sur les situations révolutionnaires arabes », Revue française de science politique, vol. 62, N° 1-2, octobre-décembre 2012.
BISSON Thomas, Les intellectuels arabes en France, Paris La Dispute, 2008.
BOURDIEU Pierre, Langage et pouvoir symbolique. Paris, Points, 2014.
BURUMA Ian et MARGALIT Avishai, Occidentalism: The West in the Eyes of its Enemies, New York, Penguin Press, 2004.
CATUSSE Myriam, SIGNOLES Aude et SIINO François, « Révolutions arabes : un événement pour les sciences sociales ? » Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, 2015.
CHERKAOUI Mohamed, « Dilemmes de la recherche et crise de la vocation scientifique », in Mohamed Cherkaoui (dir.), Crise de l’université : Le nouvel esprit académique et la sécularisation de la production intellectuelle, Genève, Droz, 2011, pp. 109-116.
EL KENZ Ali, « Les sciences humaines et sociales dans les pays arabes de la Méditerranée », Insaniyat, n° 27, jan.–mars 2005, pp. 19-28.
HANAFI Sari, MEDJAHD Mustapha et BENGHARIT-REMAOUN Nouria, Mustaqbal el-u’lûm el ijtimâ’ya fi el-â’lam el-a’rabi (Avenir des sciences sociales dans le Monde Arabe), Centre d'Étude de l’Unité Arabe, Beyrouth, Dar en-Nahda, 2014.
HANAFI Sari et ARVANITIS Rigas, Knowledge Production in the Arab World. The impossible promise, New York, Routledge, 2016.
JACQUEMOND Richard, « Les Arabes et la traduction : petite déconstruction d’une idée reçue », La pensée de midi, vol. 21 N°2, 2007, pp. 177-184.
KIENLE Eberhard (éd.), Les sciences sociales en voyage. L’Afrique du nord et le Moyen-Orient vus d’Europe, d’Amérique et de l’intérieur. Paris, IReMEM - Karthala, 2010.
LAHOUARI Addi, « Sciences sociales et débat intellectuel dans le monde arabe », Revue des Sciences Sociales, Faculté des Sciences Sociales de l’Université Mohamed Ben Ahmed Oran2, n° 6, 2018, pp. 15-36.
MAHMOOD Saba, Politics of Piety. The Islamic Revival and the Feminist Subject, New York, Princeton University Press, 2005.
ROMANI Vincent, « Enseignement supérieur, pouvoirs et mondialisation dans le monde arabe », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, n° 131, 2012.
SAID Edward, L’orientalisme. L’Orient créé par l’Occident, Paris, Seuil, 2005.
SIINO François, « Sciences, savoirs modernes et pouvoir dans le monde musulman contemporain », Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, 2003.
UNDP, Arab Fund for Economic and Social Development, The Arab Human Development