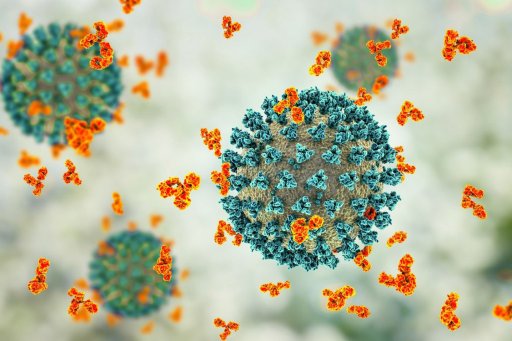Votre thèse porte sur les méthodes d’identification des fossiles humains anciens à partir des protéines. Quels sont les liens entre la chimie et l’évolution humaine ?
Lorsque l’on fouille un site archéologique, on trouve une quantité de choses différentes. Il faut alors déterminer de quoi il s’agit. Dans le cas des ossements, le principal défi consiste à les identifier. Je travaille avec des ossements datant du Pléistocène, une époque géologique qui s’étend de 2,58 millions d’années à 11 700 ans avant notre ère. Plus précisément, je travaille sur des restes de squelettes datant de - 45 000 à - 35 000 ans. Il faut donc imaginer des os très fragmentés, ce qui rend difficile leur identification par leur morphologie : proviennent-ils d’un animal ? d’un humain ? Nous pouvons répondre à ces questions par des méthodes moléculaires.
Il n’y a pas beaucoup de laboratoires qui peuvent faire ce genre d’analyse. Nous recevons donc des vestiges archéologiques de toute l’Europe. Les ossements peuvent provenir d’Allemagne, d’Italie, du Portugal… Nous utilisons différentes méthodes pour les identifier, mais l’objectif est toujours le même : extraire du matériel protéomique et le comparer à une base de données en ligne pour l’identifier. Nous essayons d’être aussi peu invasifs que possible et le plus précis qui soit.
Votre méthode consiste à utiliser des protéines pour effectuer un tel travail…
J’ai longtemps travaillé sur l’analyse de l’ADN ancien, qui est à ce jour la méthode la plus reconnue pour analyser le matériel osseux archéologique. Malgré ses avantages, elle présente certaines limites, car l’ADN se dégrade généralement plus vite que les protéines au fil des siècles. Lorsque nous trouvons un fragment d’os, les molécules d’ADN sont également fragmentées. Si nous avons de la chance, nous n’avons que quelques microgrammes d’ADN à exploiter. Parfois, il n’en reste rien. Nous devons développer des méthodes qui conviennent principalement aux protéines dégradées, c’est-à-dire hautement détruites, et à de très petites quantités de celles-ci. J’ai opté pour l’extraction de protéines parce qu’elles nous permettent de remonter plus loin dans le temps.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Dans la méthode que nous essayons d’améliorer avec mon directeur de thèse, le Pr Jean-Jacques Hublin, il y a deux étapes. Tout d’abord, nous devons extraire les protéines. Cela prend environ trois jours pour deux cents échantillons d’os. Ensuite, nous procédons à une analyse spectrométrique puis informatique. Cette étape ne dure qu’une journée. Cette analyse nous donne la séquence des protéines. C’est à partir de cette analyse que nous pouvons leur attribuer des espèces par comparaison avec une base de données en ligne. C’est l’identification taxonomique, qui peut prendre d’une semaine à un mois en fonction du nombre de spécimens analysés. L’un des avantages de cette méthode est donc sa relative rapidité.
Avez-vous une vision très large de l’histoire de l’humanité ou plutôt une vision de chimiste, plus proche du processus d’identification des fossiles ?
Je dirais que la chimie est l’outil, et que la compréhension de l’évolution humaine est la réponse. Ma première curiosité concernait surtout la science et la chimie. J’ai été fascinée par le défi d’extraire le maximum d’informations précises des matériaux dégradés. Ma discipline accompagne les progrès de la science et notre compréhension de l’histoire humaine. Si mon point de vue est d’abord celui de la chimie, il est toujours stimulant de voir comment elle influe sur notre connaissance de l’évolution.
Que ressentez-vous lorsque vous tenez un fossile d’os humain dans votre main ?
À mes débuts, je ne travaillais qu’avec de l’ADN humain. Au départ, bien sûr, j’avais des sentiments mitigés vis-à-vis des restes osseux. Mais avec le temps, on se familiarise et on sait comment gérer cette situation. C’est vraiment un sentiment unique de penser que de si petits fragments d’os provenant d’organismes morts depuis des millénaires puissent être utiles à l’humanité. Je pense que la chose la plus choquante pour moi a été lorsque nous avons eu des enfants, et que je pouvais m’en rendre compte simplement par la taille de l’os. Encore une fois, j’ai essayé de me concentrer sur les avantages de cette analyse.
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ?
Il y a deux difficultés principales dans mon travail. La première, et la plus importante, est la qualité et la quantité des matériaux fossiles. Ce ne sont pas des matériaux inépuisables, ce qui est un véritable défi pour nous. Lorsque vous trouvez un os de Néandertal, vous faites bien sûr très attention à la manière dont vous le traitez et à la quantité que vous utilisez pour vos analyses. L’argument majeur en faveur de notre technique est que nous n’utilisons que 5 mg de l’os. Nous essayons d’avoir un impact minimal. L’autre point de difficulté concerne la précision de la base de données que nous utilisons pour l’identification des espèces. Dans cette base de données, certains protéomes, c’est-à-dire l’ensemble des protéines d’une cellule, pourraient ne pas être disponibles, en particulier pour les espèces disparues comme les rhinocéros laineux et les mammouths.

Avez-vous un souvenir qui aurait été le point de départ de votre intérêt pour votre discipline ?
En Grèce, nous avons la Fondation pour la recherche et la technologie. Elle dispose d’un laboratoire consacré à l’ADN ancien qui est lié à l’université de Crète où j’ai étudié. Il y a maintenant quelques années, ils ont organisé un festival scientifique. Mes amis et moi y sommes allés pour voir les expositions et leur type de recherche. J’ai découvert ce laboratoire d’ADN ancien qui m’a intéressé, et je suis entrée en contact avec des personnes y travaillant. J’ai contacté le Pr Kafetzopoulos et j’y ai fait mon mémoire de licence. C’est ainsi que j’ai découvert que ce domaine existait et que la chimie pouvait être utile dans ce domaine. Avec une formation en chimie, on peut travailler dans tous les domaines possibles et imaginables, même ceux auxquels on n’a jamais pensé. Pour moi, c’est un défi supplémentaire de travailler avec des os hautement dégradés et de développer des méthodes appropriées pour analyser ce type de matériel.
Vous voyagez dans différents pays pour vos études, avez-vous remarqué des différences dans votre façon de travailler ?
J’ai commencé mes études en Grèce, d’où je viens, et j’ai ensuite travaillé au Danemark, en Allemagne, aux Pays-Bas, et maintenant en France. Il y a toujours des différences, en fonction du matériel et des questions de chaque projet. Mais chacun d’entre eux est tout aussi fascinant pour moi. De plus, le fait de travailler avec différentes personnes issues de domaines disciplinaires très variés m’a permis de percevoir les perspectives distinctes, mais complémentaires de nos recherches.
Diriez-vous que vos recherches ont changé votre perception de notre espèce ?
L’une des questions que nous nous posons est de savoir quand et pourquoi nos ancêtres directs ont quitté l’Afrique et quels étaient leurs comportements. Le passé recèle de nombreux mystères, et c’est en les résolvant que nous pourrons comprendre le présent et imaginer le futur. Cela peut être très décevant parfois, mais aussi unique. Il peut apporter des réponses dont on ne soupçonnait même pas l’existence. Je pense que c’est ce qu’il y a de bien avec la science. On peut parfois le pressentir, mais on ne sait jamais ce qui va suivre, et c’est parfois surprenant.
Dorothea Mylopotamitaki est doctorante au sein de l’équipe Paléoanthropologie du Centre interdisciplinaire de recherche en biologie du Collège de France sous la direction du Pr Jean-Jacques Hublin, titulaire de la chaire Paléoanthropologie et du Dr Frido Welker (université de Copenhague). Sa thèse s’intitule « MS/MS-Based Bone CHIP Species Identification ».
Photos © Patrick Imbert
Propos recueillis par Aurèle Méthivier