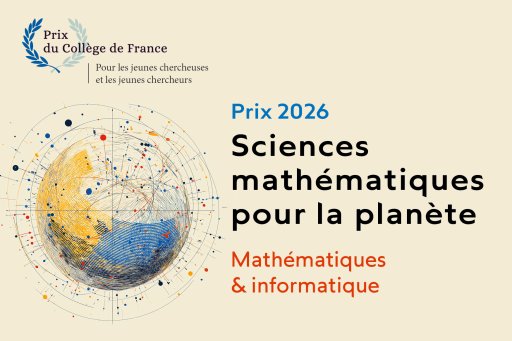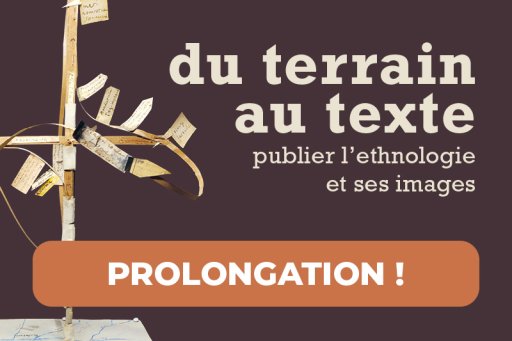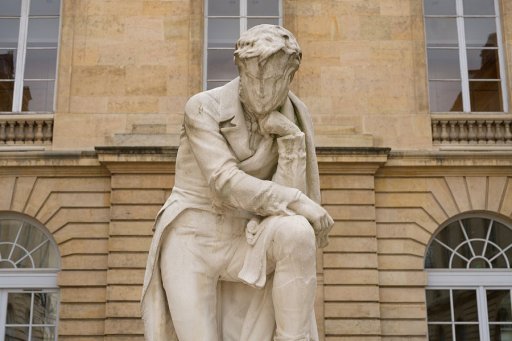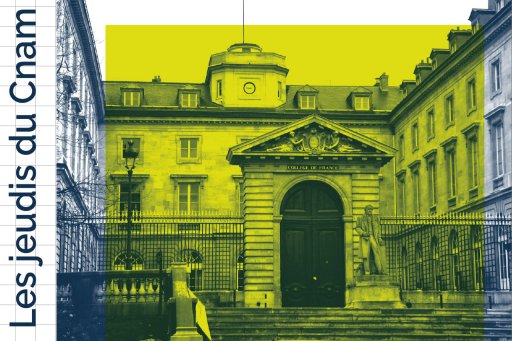Les citoyens peuvent-ils prendre des décisions importantes sans avoir recours systématiquement à des représentants politiques ? En s'appuyant sur l'exemple du fonctionnement de la démocratie athénienne, la philosophe Chloé Santoro trace les contours d’un régime démocratique fondé sur une citoyenneté active et délibérative. Elle décrit ainsi une architecture institutionnelle capable de produire de l’intelligence collective, à travers les processus décisionnels, mais aussi les pratiques de sociabilité ou la formation du jugement critique.
Chloé Santoro, chercheuse au sein de la chaire délibération du Laboratoire interdisciplinaire d’étude du politique Hannah Arendt (LIPHA), à l’université Paris-Est-Créteil, et chercheuse associée au laboratoire Logiques de l’agir à Besançon, est lauréate 2025 du prix du Collège de France pour les jeunes chercheuses et les jeunes chercheurs.
Elle donnera une conférence intitulée « Athènes : la démocratie comme institution de l’intelligence collective » au Collège de France, le 10 décembre 2025 à 18 heures.
Vous dites que nos démocraties font face à un paradoxe. Pourquoi ?
Chloé Santoro : Dans nos régimes représentatifs, le peuple est souverain, mais il n’exerce paradoxalement sa souveraineté qu’en désignant un représentant qui décidera à sa place. C’est, selon moi, cette conception paradoxale de la démocratie qui explique en partie la profonde crise de légitimité à laquelle nous assistons aujourd’hui. Les aspirations à des formes plus intégrées et plus authentiques de démocratie sont fortes, néanmoins, à l’exception du cas suisse, les électeurs ne sont que très peu consultés dans nos régimes actuels. Ils n’interviennent que sur des décisions mineures. Deux arguments, rarement remis en question, permettent de le justifier : d’une part, les citoyens ordinaires sont jugés incompétents pour gouverner, et d’autre part, le grand nombre est considéré comme un handicap. Or, il existe un précédent où ces deux présupposés ont été démentis : la démocratie athénienne antique.
Je me suis, en effet, intéressée à Athènes parce que je voulais comprendre s’il était possible que des citoyens ordinaires puissent prendre des décisions importantes sans s’en remettre à des représentants politiques. Mes principales questions concernaient l’intelligence collective : qu’est-ce que c’est ? Est-ce que cela existe vraiment ? Comment la construit-on, avec quelles pratiques sociales et quelles institutions ? Ce qu’il m’intéressait de comprendre, c’était le « modèle épistémique » de la démocratie athénienne, c’est-à-dire comment, à l’époque d’Athènes, les savoirs, les compétences et les capacités des citoyens étaient organisés et utilisés pour participer à la vie politique.
Quelles conclusions tirez-vous de vos travaux ?
Un des premiers constats de ce travail, c’est l’étrangeté du régime athénien par rapport à nos cadres de pensée et pratiques politiques. Par exemple, à Athènes, les décisions se prenaient selon une logique qui se révèle contre-intuitive au sein de nos régimes représentatifs : plus une décision était importante, plus les Athéniens estimaient qu’il fallait de monde pour la prendre. Cette corrélation entre la gravité de la décision et le nombre de décideurs, c’est ce qui fait selon moi l’essence d’une vision « radicale » de la démocratie.
Dans mon travail, j’essaie de poser les jalons d’une démocratie que je nomme radicale, et qui se veut opposée à la démocratie représentative. Si la démocratie radicale existe déjà comme concept, je suis en désaccord avec la façon dont elle a été pensée comme un type d’organisation naturelle. Au contraire, Athènes nous montre que la souveraineté populaire n’a pas seulement besoin de s’exprimer. Elle doit être construite, sur le temps long, par des institutions plutôt complexes. Je développe par conséquent un concept original de démocratie radicale, centré sur la question de l’apprentissage.
Ce choix a aussi été motivé, selon vous, car les sources philosophiques dont nous disposons à l’heure actuelle sont biaisées…
Même si je suis philosophe de formation, je me suis très peu appuyée sur les théories philosophiques de la démocratie, pour plusieurs raisons. Tout d’abord, l’historiographie a beaucoup progressé ces dernières années. Certaines théories de la démocratie, que je qualifierai « d’élitistes », ont perdu du terrain grâce aux avancées dans cette discipline. Par exemple, la lecture décliniste de la participation athénienne à partir de la deuxième période démocratique à Athènes, qui prévalait il y a encore trente ans, ne tient plus aujourd’hui auprès des historiens. La théorie politique n’a pas encore complètement intégré ces évolutions. C’était un objectif de ma thèse : que le mélange de radicalité et de pragmatisme qui caractérise ce régime soit à la fois mieux compris et davantage pris au sérieux.
De plus, certains textes philosophiques ont été relativement mieux conservés que d’autres sources. Je pense en particulier à des textes comme ceux de Platon ou d’Aristote, dont nos théories philosophiques sont imprégnées. Or, d’un point de vue historique, la vision que portent ces textes classiques est décalée. Platon, par exemple, défend un modèle élitiste selon lequel celui qui prend la décision politique doit être soigneusement choisi pour ses caractéristiques personnelles et disposer de solides compétences pour gouverner. C’est paradoxal, pourtant, ce modèle est beaucoup plus compatible avec l’idéologie technocratique qui sous-tend nos institutions représentatives contemporaines qu’avec l’idéologie dominante et les institutions de son époque.
Concrètement, comment les Athéniens gouvernaient-ils ?
D’une part, ils s’en remettaient au vote de milliers de citoyens présents à l’Assemblée, plutôt qu’à un représentant, pour prendre les décisions d’importance sur le plan politique. D’autre part, le gouvernement athénien reposait massivement sur le tirage au sort de citoyens ordinaires, qui étaient des milliers chaque année à se consacrer à leur cité, préparant les séances de l’Assemblée ou jugeant les procès, pour une centaine d’élus seulement. Le tirage au sort est un mode de sélection que nous recommençons à expérimenter aujourd’hui, qui reste encore marginalisé par rapport aux espaces de décision, alors que c’est une façon de favoriser non seulement une certaine diversité sociale, mais aussi cognitive. À Athènes, les tirages au sort s’effectuaient selon le système clisthénien, c'est-à-dire selon une répartition assez complexe de la population dans des « tribus », au sein desquelles des citoyens issus de différents types de territoires étaient mélangés. C’est une particularité qui reste très mal connue du grand public aujourd’hui alors qu’elle jouait un rôle fondamental, en assurant un brassage constant de la population civique et en établissant des liens de confiance par-delà les appartenances sociales.
Vous avez effectué une immersion au sein de la Convention citoyenne pour la fin de vie. Pourquoi ?
La société athénienne antique reste très différente de la nôtre, et nos sources sont parcellaires. Même si l’historiographie a beaucoup progressé sur la connaissance des institutions politiques, il subsiste des zones d’ombre sur la façon dont s’organisait au jour le jour la démocratie athénienne, faute de description exhaustive dans les textes anciens. Par exemple, nous avons une visibilité restreinte sur la façon dont les délibérations se déroulaient, ou sur le sens de certaines réformes.
Il fallait donc que je puisse confronter certaines de mes hypothèses à une assemblée en cours d’exercice, réfléchir par analogie. La Convention citoyenne sur la fin de vie (CCFV), qui a réuni cent quatre-vingt-quatre citoyens et citoyennes français ordinaires pendant neuf week-ends, entre 2022 et 2023, pour délibérer sur le sujet du cadre légal de la fin de vie, se prêtait à cette observation. Comme à Athènes, les citoyens avaient été tirés au sort pour participer à cette expérience. Je voulais comprendre ce que cela changeait par rapport à d’autres modes de sélection. Je me suis aussi intéressée à la façon dont les mécanismes de la sociabilité influencent les individus au cours des délibérations et au moment du vote. Mon immersion au sein de la CCFV m’a ainsi permis d’observer comment des relations se construisaient entre les votants, comment ils accordaient ou retiraient leur confiance aux uns et aux autres. Cette dimension affective de la façon dont nous faisons la démocratie, ou, pour le dire plus simplement, la façon dont l’intelligence collective se construit avec le cœur, c’est ce qui m’échappait au sujet d'Athènes... J’avais besoin de pouvoir l’observer de beaucoup plus près.
Comment devient-on, en fin de compte, un citoyen éclairé et autonome ?
Je dirais que la vraie question démocratique est celle de l’autonomie collective, et que cela ne s’improvise pas. La sociabilité est essentielle et il faut du temps pour la construire. Un groupe se construit en partageant des temps communs, que ce soit à travers les repas, les rires, etc. Ces temps contribuent à la qualité du débat démocratique. Cela signifie qu’il ne faut pas seulement considérer la délibération, mais aussi les temps informels pour laisser la possibilité à la réflexion collective de se construire. Individuellement, cela exige aussi de l’entraînement. Certes, les citoyens athéniens pouvaient être tirés au sort, cependant, ils avaient bien d’autres occasions de se coordonner et d’exercer leur jugement critique au travers d’événements collectifs. Ils étaient beaucoup plus entraînés que nous sur ce plan.
Ce que j’entends par entraînement, c’est la possibilité, au sein de multiples activités quotidiennes, d’exercer son jugement critique en tant que citoyen. Par exemple, pour se rendre au théâtre, les citoyens d’Athènes étaient rémunérés. Cette activité était considérée comme faisant partie de la citoyenneté – et je pense qu’il est important de comprendre ce que cela implique. Bien sûr, on pourrait souligner que les Athéniens disposaient de plus de temps que nous pour ce genre d’activités puisque, même si la plupart travaillaient, ils avaient aussi en général des esclaves qui pouvaient se charger des tâches quotidiennes. Toutefois, je pense que la participation citoyenne dans une démocratie n’est pas un luxe, et le fait qu’elle ait été rémunérée à Athènes, y compris sous ses formes « festives », le montre bien.
Comment éviter, selon vous, les écueils que nous avons produits jusqu’ici ?
Participer à la décision publique demande du temps et de l’investissement. Dans le cas de la Convention citoyenne sur la fin de vie, les participants devaient par exemple se faire un avis sur la pratique actuelle de la sédation profonde et continue jusqu’au décès. Certains ont alors tenu à organiser, de leur propre initiative, des visites dans des hôpitaux et dans des services de réanimation afin de pouvoir se rendre compte de ce que cela signifiait concrètement. Je dirais qu’il est parfois difficile d’avoir une réflexion abstraite sur certains enjeux. Pour comprendre une question comme la fin de vie, il faut pouvoir se représenter l’impact que cela aura sur les familles, quelque chose qui relève de l’intime. L’entraînement, lui, peut aider à gagner en expérience et à la mettre en commun avec les autres, de sorte que le groupe développe peu à peu son discernement.
Bien entendu, il n’est pas toujours possible de prendre des décisions collectives, en particulier dans des cas d’urgence. Les citoyens de l’Athènes classique en étaient aussi conscients, et il était possible que certains stratèges militaires ou diplomates doivent décider en l’absence de consultation. Cependant, leurs agissements étaient scrutés de près et ils devaient rendre des comptes pour les décisions prises en autonomie. Et c’est le bon raisonnement à avoir, selon moi. À savoir qu’il nous faut reconnaître que toute forme de délégation en démocratie est un pis-aller.
Propos recueillis par Emmanuelle Picaud, journaliste scientifique