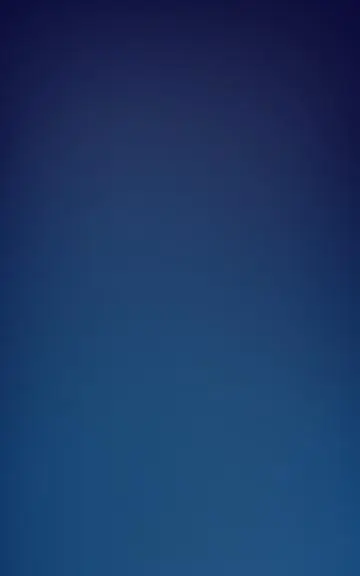Journée d'étude organisée par Patrick Boucheron, chaire Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe-XVIe siècle, et Antoine Lilti, chaire Histoire des Lumières, XVIIIe-XXIe siècle.
Présentation
Cette demi-journée de discussions et de réflexions vise à questionner l’opposition, devenue lieu commun, entre deux formes d’histoire. La première serait engagée, subjective et militante ; la seconde, neutre, objective et savante. Or, chacun sait bien que les engagements des historiens et des historiennes sont multiformes et ne nuisent pas nécessairement aux ambitions scientifiques de leurs travaux, tandis que la stricte objectivité est une illusion qu’un minimum de réflexivité épistémologique dissipe. Il s’agit donc de réfléchir, collectivement, à toutes les formes de croisements, d’interactions, d'échanges. Comment le travail savant des chercheurs peut-il nourrir leur engagement (politique, social, moral…) ? Comment une histoire militante, parfois produite en marge du monde universitaire, peut contribuer de façon décisive, aux progrès de la recherche, en imposant de nouveaux objets, de nouvelles sources, de nouvelles approches ? Pour autant, questionner n’est pas abolir. On se gardera d’effacer la distinction entre une histoire à visée savante et une histoire produite dans un cadre militant. On essaiera alors de comprendre aussi comment la vigueur de l'engagement et la rigueur de la science peuvent, parfois, entrer en conflit.
Intervenants :
- Ludivine Bantigny
- Malika Rahal
- Guillaume Cuchet
- Marion Fontaine
- Guillaume Mazeau
- Delphine Diaz