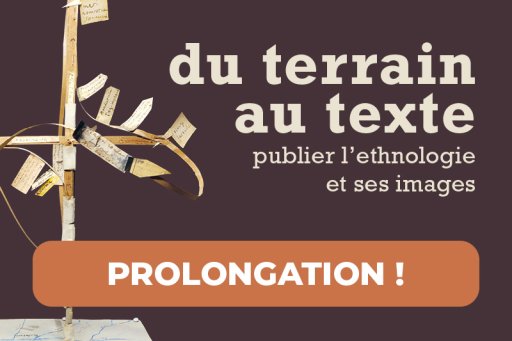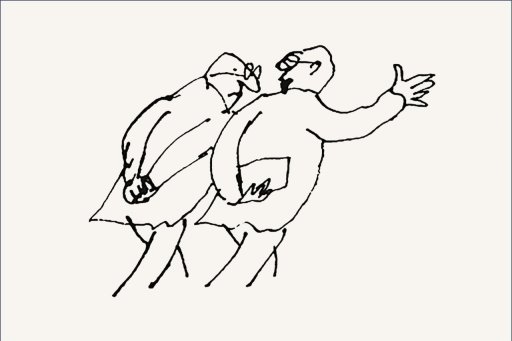La revue Entre-Temps se situe dans un espace qui ne nécessite aucun prérequis érudit
À la croisée de différents publics et de différentes temporalités, Entre-Temps est une revue d’histoire actuelle, collective et entièrement gratuite. Pour le quatrième anniversaire de son lancement sur le Web, son directeur de la publication, le Pr Patrick Boucheron, nous raconte l’histoire et les enjeux de cette revue atypique.
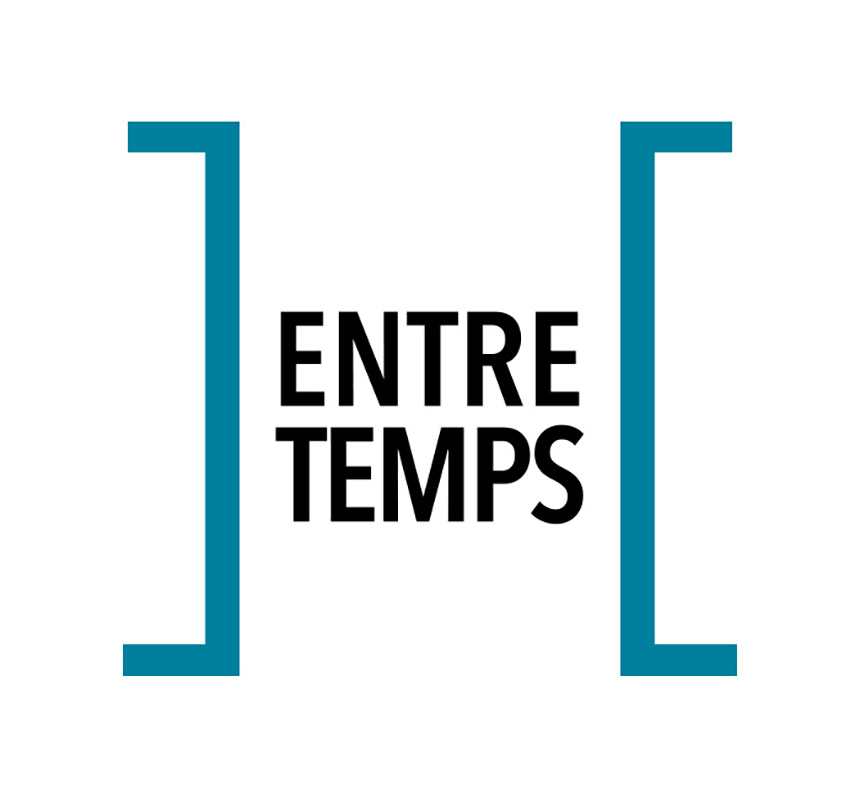
Pourquoi dans l’à-propos que l’on peut lire sur votre site web, définissez-vous votre revue comme un service public de l’histoire ?
Patrick Boucheron : Le projet initial était de considérer qu’en matière d’écritures numériques de l’histoire, il y avait déjà beaucoup à glaner sur le Web, et qu’une de nos responsabilités, pour une institution comme le Collège de France, était de donner à voir ce qui existait déjà, de l’éditorialiser, et de donner à voir les formes émergentes dans le champ de la discipline historique. L’idée était qu’on a peut-être moins à inventer qu’à inventorier, que l’audace et l’innovation sont déjà présentes. C’est ce travail de veille, de collecte et d’éditorialisation qui constitue notre mission de service public : on avait alors l’idée d’un espace de création ouvert, gratuit et accessible, notamment aux collègues du secondaire. Il y avait donc aussi l’ambition de rendre compte de ce qu’il y a avant les livres, dans les blogs et les carnets de recherche, toutes ces écritures qui ne se manifestent pas encore dans la forme même du livre.
Avec Adrien Genoudet, qui a été ATER sur ma chaire pendant trois ans et qui a impulsé les premières années de la revue Entre-Temps, on est donc parti de cette idée. Elle n’a pas été tout à fait abandonnée, puisqu’elle existe encore sous la forme de différentes rubriques (notamment celle qui s’appelle « Exhumer »). Il reste la conviction renouvelée qu’il ne s’agit pas d’une revue, au sens où elle aurait à défendre une ligne éditoriale qui lui serait propre, qu’il ne s’agit pas d’une école, qu’il ne s’agit pas d’un espace militant, mais d’un lieu de visibilité, d’éditorialisation et de reconnaissance.
À qui s’adresse la revue ? Spécialistes ou grand public ?
Je ne pense pas que ce soit le grand public. Dans mon activité générale, qui joue sur une gamme que j’espère la plus variée possible entre l’histoire savante et l’histoire publique, je tente de doser, au plus juste, les différentes formes d’adresse : on n’écrit pas dans une revue spécialisée comme on parle à la radio. Le nom de la revue, Entre-Temps, s’entend aussi comme un entre-deux. Entre le tempo frénétique de l’actualité des réseaux sociaux, et donc la volonté de réagir, et celui beaucoup plus lent des revues savantes ou des productions artistiques. Entre-Temps se veut être déjà l’expression de cet entre-deux de la temporalité, mais c’est sans doute aussi un entre-deux des publics. C’est-à-dire que l’on est là dans un espace qui n’est pas réservé, qui ne nécessite aucun prérequis érudit, mais qui s’intercale entre le grand public, la vulgarisation et l’espace professionnel des historiennes et historiens de métier — sans oublier tous les métiers de la culture et de la création. Un lieu où un lectorat d’histoire ou de sciences humaines pourrait s’intéresser à autre chose qu’à son sujet de prédilection, mais avec un niveau d’exigence à peu près équivalent.
Vous avez créé cette revue quatre ans après votre arrivée au Collège de France. Pourquoi à ce moment-là ? Est-ce que l’élaboration de ce média a enrichi vos travaux et par là même vos enseignements dans notre institution ?
C’était le temps du développement. J’avais eu l’idée tout de suite, dans les termes que j’ai définis avec vous, et si elle a évolué c’est aussi parce que je l’ai accordée au désir de l’équipe de jeunes chercheurs qui s’est alors réunie, et renouvelée depuis — lorsque Élisabeth Schmit, puis aujourd’hui Pauline Guillemet, l’une et l’autre successivement ATER sur ma chaire, en ont pris la responsabilité. Cette équipe avait une envie créative autour de leurs recherches, sur la visualité, la bande dessinée, le cinéma documentaire… que je n’ai pas voulu réfréner. Évidemment, elle me nourrit. C’est un lieu dont j’attends qu’il me ménage quelques surprises et qu’il me fasse cheminer sur des voies que je n’avais pas soupçonnées ou prévues. J’ai eu le souci de l’indépendance, sinon de l’autonomie de ce média et de son équipe. Pendant très longtemps, je ne l’ai pas articulé avec les activités de la chaire en elle-même, car j’avais vraiment scrupule à en faire une tribune. Elle ne l’est toujours pas, mais j’hésite moins désormais à en faire la chambre d’écho de ce que je propose ailleurs, au Collège de France en premier lieu, mais aussi sur Arte, France Inter, et dans les théâtres publics où je me produis parfois.
Cela n’empêche pas des thématiques communes, comme la question de l’archive ou plus précisément la mise en scène de l’archive de soi, qui ont donné lieu à quelques « séries » dans la revue. Toutefois, il ne faut pas que cette manière d’être « entre » ou à côté devienne une coquetterie consistant à vouloir à tout prix ne pas être dans l’actualité. L’assassinat de Samuel Paty et la guerre en Ukraine ont, par deux fois, fait sortir la revue de sa programmation habituellement distanciée, et nous avons, je crois, progressé (en visibilité, mais aussi en réflexivité) en acceptant de faire face à l’effraction du réel.
En plus des historiens, des artistes, plasticiens, écrivains, contribuent à la revue. Pourquoi avez-vous tenu à leur présence ?
Cela fait partie d’une palette d’activités et d’adresses, qui irait du public le plus académique au plus grand public. Ce n’est pas le lieu d’expression académique pour moi, et ce n’est pas non plus un lieu de vulgarisation, même si certains collègues, notamment de l’enseignement secondaire, y racontent des dispositifs pédagogiques.
Cela rend compte d’un intérêt ou d’une attention générale aux formes de mise en présence du passé qui ne sont pas seulement celles de l’espace académique. L’écriture académique de l’histoire n’est qu’une des formes de mise en présence du passé. L’essentiel de notre travail réside dans l’inventaire critique des différentes formes d’écritures : visuelles, télévisuelles, cinématographiques, bédéistes, ludiques… Il s’agit en somme de promouvoir une histoire qui sait se rendre accueillante à tout ce qui la déborde. Cela élargit le cadre de l’histoire, d’où la volonté de faire écrire des historiennes et historiens de profession qui sont intéressés par ces nouvelles écritures. Mais aussi de demander directement à des créateurs, vidéastes, écrivains ou autres, d’engager avec nous une conversation sur la portée historique ou du moins sur la consistance historienne de leur travail. Rapporté à nos catégories administratives, on dirait que c’est de la « recherche et création ».

Comment se situe Entre-Temps par rapport aux autres revues d’histoire, depuis L’Histoire, très grand public, ou la revue Annales, histoire et sciences sociales, beaucoup plus académique ?
Ce sont des revues que je connais très bien. J’ai rejoint le comité de rédaction de la revue L’Histoire en 1999. Ce furent nos premiers partenaires, avec Emmanuel Laurentin qui produisait La Fabrique de l’histoire sur France Culture, mais aussi mes complices habituels comme le théâtre de la Colline à Paris, le Grand T à Nantes et le théâtre national de Bretagne, à Rennes, où je suis chercheur associé… Il est sûr qu’Entre-Temps se situe plus du côté du magazine L’Histoire que de la revue des Annales. Entre-Temps a longtemps été une revue de textes assez longs qui pouvaient à la fois attirer et intimider. On a vraiment gagné en visibilité et en audience avec le passage à deux médias complémentaires aux textes : le podcast audio – c’est la forme originale du « Rétroviseur » – et les vidéos – les « Entrevues ». Dans le podcast audio, on va chercher une historienne ou un historien, de différentes générations, pour lui faire parler d’un article de jeunesse. Une sorte de retour, d’autoréflexivité sur une production savante. Cela rend compte d’un souci constant d’Entre-Temps de s’intéresser aux archives des historiens, je pourrais dire d’archiver l’autoarchivage des historiens. C’est quelque chose qui a été mis en scène lors de La Nuit des idées 2020 au Collège de France, ainsi que tous les ans à Blois aux Rendez-vous de l’histoire. Dans nos vidéos, il s’agit d’entretiens longs entre la rédaction et un chercheur, un créateur, un écrivain, un cinéaste.
Comment percevez-vous le paysage des revues scientifiques, aujourd’hui ? Quelles sont les grandes tendances ?
Je ne pense pas qu’Entre-Temps ait une quelconque place dans le paysage des revues scientifiques, car elle échappe aux problématiques qui sont celles de ce milieu, notamment la question économique et la question de l’évaluation. Si l’on était dans un modèle marchand, elle serait ce qu’on appelle un « micromédia », une revue de niche, qui développe d’une manière professionnelle un angle précis. Elle aurait des impératifs de recrutement d’abonnés, de promotion, de salariés et de modèle économique. Si je parle de service public, c’est aussi parce qu’on est soutenu par le Collège de France, au travers de ma chaire, et pour la production vidéo par la Fondation du Collège de France et par la Fondation Hugot.
Au-delà du modèle économique, Entre-Temps se veut aussi un espace ouvert, sans évaluation.
Oui, et cela aussi nous éloigne du monde des revues, qui ont un rôle de transmission (et même de production) du savoir, mais aussi d’évaluation des carrières. Si l’on écrit pour une revue, c’est généralement parce qu’on en espère un gain — il peut être soit directement financier, soit indirectement intéressé dans le cas d’une revue scientifique qui participe à la valorisation des carrières. Je n’oublie pas non plus les motivations qui ressortent de l’engagement, politique ou intellectuel. Dans le cas qui nous intéresse, c’est différent. On peut s’interroger afin de savoir pourquoi les contributeurs éventuels souhaiteraient confier à Entre-Temps un article, du temps, une création, sans être rémunérés et sans que cela ne leur rapporte rien dans l’évolution de leur carrière. Il faut croire qu’il existe encore un espace gratuit et désintéressé dans lequel éprouver sa liberté de chercheur, en livrant les à-côtés de sa réflexion, paraît encore désirable. C’est ici que la revue rejoint l’institution du Collège de France dans son rapport non économique et non utilitaire au savoir, dans l’esprit de curiosité qui anime cette institution qui ne délivre pas de reconnaissance symbolique par le diplôme. Et peut-être aussi, son public, qui vient tout simplement parce qu’il est animé par la curiosité.
Propos recueillis par Aurèle Méthivier