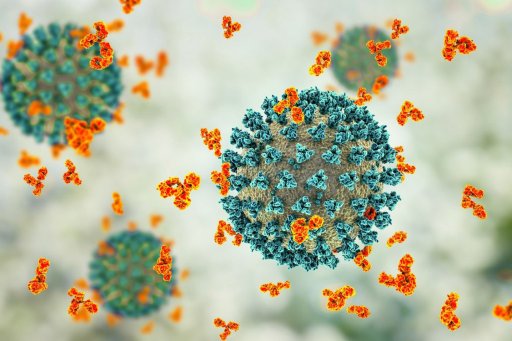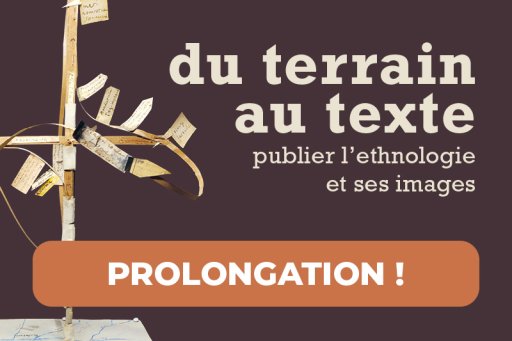Louise Gentil, sous la direction de Patrick Boucheron et François-Xavier Fauvelle, professeurs du Collège de France, mène des recherches sur l’agriculture irriguée en Italie entre le XIIIe et le XVIe siècle. Soutenue par le programme Avenir Commun Durable, l’équipe participe ainsi à la constitution du récent champ d’étude des humanités environnementales, en interrogeant notamment le rapport des sociétés préindustrielles à leur environnement.
Des paysans travaillant modestement leurs terres pour se nourrir, des éléments naturels encore difficiles à apprivoiser, de faibles récoltes… C’est souvent l’idée que l’on se fait de l’agriculture au Moyen Âge. La réalité est pourtant différente, révèle Louise Gentil, nouvellement docteure en histoire médiévale. Sous la direction de Patrick Boucheron et François-Xavier Fauvelle, professeurs du Collège de France, elle étudie le cas de l’agriculture irriguée en Lombardie entre le XIIIe et le XVIe siècle. La chercheuse tente ainsi de comprendre quel était le rapport des humains à leur environnement dans cette région du nord de l’Italie, et questionne les a priori que l’on peut avoir sur cette période.
Des systèmes agricoles complexes
« On a tendance à croire qu’au Moyen Âge, l’homme doit encore conquérir des espaces sauvages pour acquérir des ressources. Mais c’est un mythe construit par certains acteurs de l’époque, notamment les moines qui racontaient s’installer dans des déserts ou des forêts à défricher, pour les transformer en espaces productifs », explique Louise Gentil. En réalité, l’état de nature n’existe déjà plus à cette époque : l’Europe est complètement anthropisée. Il y règne une logique de gestion de l’entièreté de l’environnement, très largement mis au service de l’être humain. « On se fait aussi une fausse idée des systèmes agricoles aux époques précédant l’industrialisation : on pense souvent qu’il n’existait qu’une agriculture de subsistance subie, poursuit Louise Gentil. Autrement dit, les récoltes d’un paysan lui auraient seulement permis de couvrir ses propres besoins... Mais on observe en Lombardie des systèmes de production complexes, qui vont bien au-delà de la subsistance. » Dès le XIe siècle, cette zone géographique, le bassin versant du fleuve Pô, connaît de grands aménagements pour la gestion de l’eau : on creuse des canaux, on crée des systèmes d’irrigation des terres et des barrages régulant les flux, on construit des moulins… Des terres qui étaient destinées à la production de céréales sont alors converties en prés irrigués et utilisées pour produire du foin en très grande quantité destiné aux troupeaux ou aux cavaleries militaires milanaises. Des consortiums d’irrigation, composés d’institutions et de familles propriétaires, se forment même au XIIIe siècle pour la gestion des canaux et la défense des intérêts de chacun. Cela démontre l’existence de stratégies économiques dès le Moyen Âge : des choix de production, d’investissement, de recherche de rentabilité des terres sont déjà d’actualité. On est donc loin de l’image des paysans produisant à peine de quoi survivre…
Une agriculture nécessairement durable ?
Un autre a priori à questionner sur l’agriculture médiévale est sa supposée durabilité et son respect de l’environnement. « En histoire, l’étude de l’industrialisation a fait passer pour non intensive et durable l'ensemble des techniques de production antérieures. Mais ce n’est pas forcément le cas ! », s’exclame Louise Gentil. L’agriculture médiévale n’a certes pas le même impact que l’agriculture industrielle d’aujourd’hui, mais n’est pas, pour autant, nécessairement vertueuse. « L’agriculture médiévale est très intensive dans certains espaces, ce qui est rendu visible tant par les aménagements réalisés que par la main-d'œuvre mobilisée. En Lombardie notamment, vingt-quatre travailleurs pouvaient être employés pour l’entretien d’un seul canal d’irrigation sur une journée. » Elle pouvait aussi être destructrice : on pratiquait par exemple la culture sur brûlis, qui consiste à brûler les végétaux d’une parcelle pour ensuite pouvoir la cultiver. Une technique que l’on apparente aujourd’hui à de la déforestation.
Si ces découvertes sont précieuses et déjà riches d’enseignements, de nombreuses questions restent encore sans réponse. « On sait que les institutions ecclésiastiques étaient de grands propriétaires terriens et qu’elles ont joué un rôle majeur dans l’organisation de l’agriculture irriguée. Mais comment géraient-elles précisément leurs espaces productifs et le travail des paysans ? », questionne Louise Gentil, qui se demande également comment étaient organisés les consortiums d'irrigation, les systèmes de production et, plus largement, la société lombarde à cette époque... Elle poursuit son enquête.
Du cas particulier à une réflexion méthodologique
Pour mener à bien ses recherches, l’historienne étudie tous types de documents produits par les acteurs du monde agricole lombard au fil des siècles. Les fonds des abbayes et des communes sont des bases de données importantes. Elle travaille, par exemple, sur des actes notariés de l’époque et de nombreuses cartes de la région, tant médiévales que récentes. « Mais la manière dont on aborde les sources est un enjeu primordial. Il faut veiller à ne pas projeter notre vision actuelle de la production agricole sur ces espaces », précise Louise Gentil. Elle s’emploie aussi à la création d’une base de données cartographique, nourrie de toute la documentation spatiale qu’elle a pu glaner. « Pour représenter l’évolution des cours d’eau et des canaux au fil des siècles, j’utilise un SIG, un système d'information géographique. Cela pose de nombreuses questions, car le but est de créer un outil numérique permettant de travailler à plusieurs chercheurs qui pourraient tous accéder à ces données et les modifier. En somme, créer de l’interopérabilité ».
Ces enjeux méthodologiques occupent une place majeure dans le travail de l’historienne, qui a adopté une position réflexive dès le début du projet. Il s’articule, en effet, entre une enquête sur l’agriculture en Lombardie médiévale et une réflexion sur le cadre même de ce travail. L’une nourrit l’autre. Louise Gentil étudie un cas particulier mais réfléchit, quand elle en rencontre, aux enjeux plus globaux de cette recherche. « Le but est de construire une discussion qui soit utile à tous les chercheurs qui voudraient mener des projets de ce type. D’autant plus que l’histoire environnementale française s’est longtemps concentrée sur l’industrialisation et ses prémices, laissant peu de place à d’autres questionnements. Quel cadre méthodologique met-on en place, quand on veut commencer une enquête en histoire de l’environnement pour les périodes préindustrielles ? », s’interroge l’équipe du projet.
Penser les humanités environnementales
Patrick Boucheron, François-Xavier Fauvelle et Louise Gentil mènent donc des réflexions sur ce champ de recherche qu’ils nomment les « humanités environnementales ». Un terme encore peu usité. « Les chercheurs ont plutôt tendance à dire qu’ils font de l’histoire environnementale, de l’archéologie environnementale, de la philosophie environnementale… Mais nous parlons volontairement d’humanités environnementales, un champ d’étude résolument interdisciplinaire et encore récent », signale Louise Gentil. Il s’agit en effet de faire converger différents regards, différentes disciplines, dans le but de répondre à de nouvelles interrogations. En une vingtaine d’années, les problématiques environnementales sont entrées au cœur des préoccupations sociétales et ont impacté toutes les sciences sociales. Face à la destruction de son milieu de vie, la société a cherché à mieux connaître les périodes antérieures pour en tirer des enseignements. « Les enjeux environnementaux ont ainsi renouvelé le questionnaire scientifique. On interroge les mêmes sources, mais de manière différente, en se demandant par exemple s’il est possible d’en dégager un paysage ou un certain usage des ressources. On se demande désormais comment les médiévaux pensaient leur environnement, leurs ressources… » À cela s’ajoutent des données scientifiques inédites, fournies par de nouvelles méthodes de recherche développées à partir des années 1970. Les techniques récentes de carottage glaciaire ou sédimentaire, de la palynologie[1] ou encore de la dendrochronologie[2] apportent de nouveaux indicateurs sur les climats anciens ainsi que sur les usages de l'environnement par les sociétés. Face à ce foisonnement de questions et de documentations, l’équipe souhaite obtenir un mode d’emploi théorique clair.
Une journée d’étude pour poser un cadre théorique
Parce qu’il existe encore peu d’ouvrages, de colloques ou d’espaces d’échange théorique sur ces questions, les trois chercheurs ont décidé d’organiser une journée d’étude. « Le Collège de France est un lieu qui se prête particulièrement bien à cette discussion, et le programme Avenir Commun Durable nous permet de poser un cadre de travail solide pour de longs projets de recherche », souligne Louise Gentil. L’équipe va donc réunir des spécialistes de différentes disciplines – archéologie, histoire, anthropologie, philosophie… – qui travaillent depuis plusieurs années sur les relations entre humains et environnement. On comptera notamment parmi eux l'historien Grégory Quenet, le philosophe Pierre Charbonnier et l’archéogéographe Magali Watteaux. Les chercheurs pourront faire un état des lieux de leurs travaux, expliquer en quoi leurs problématiques ont évolué ou encore partager les bonnes pratiques observées lors de leurs enquêtes et qui gagneraient à être diffusées. Mais cette mise en commun des savoirs ne s’arrête pas là. « On se demandera alors comment travailler tous ensemble. Il faut imaginer des manières de collaborer entre chercheurs de différentes disciplines, mais aussi se demander comment former les étudiants. Selon moi, cela commence par se mettre d'accord sur des termes, sur un questionnaire, sur une manière commune de concevoir les enquêtes », complète l’historienne. Elle espère que cette journée d’étude aboutira à la création d’un groupe de réflexion à plus long terme. De quoi habilement contribuer au développement des humanités environnementales.
Salomé Tissolong, journaliste
[1] La palynologie étudie les pollens et les spores actuels ou fossilisés afin de retracer les variations de l’environnement végétal sur de très longues périodes.
[2] La dendrochronologie est une méthode scientifique de datation des événements passés ou des changements climatiques par l’étude des anneaux de croissance des troncs d’arbre.