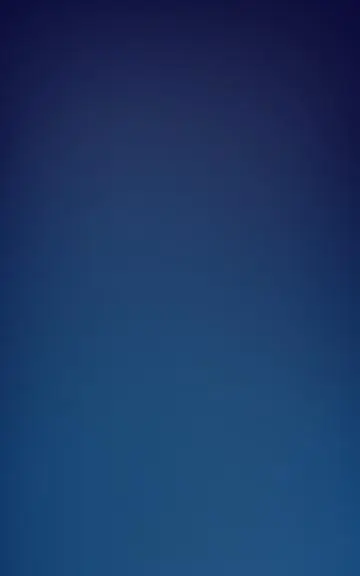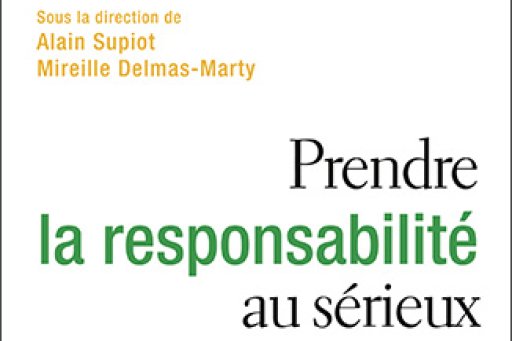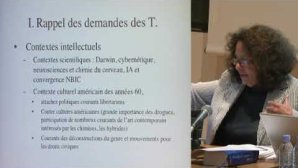Travaux
« C’est à partir du doctorat que le droit a commencé à m’intéresser, avec une thèse en droit pénal des affaires. Cette discipline, dont relevaient les scandales immobiliers de l’époque, n’existait pas encore vraiment. C’est ainsi que s’est ouverte une voie étrange qui est restée la mienne tout au long de ma vie : travailler sur ce qui n’existe pas, ou pas encore. Repérer les signes d’émergence, essayer de voir où ils mènent, parfois tenter de les infléchir ». Portrait par Virginie Bloch-Lainé, Libération 28 juillet 2017