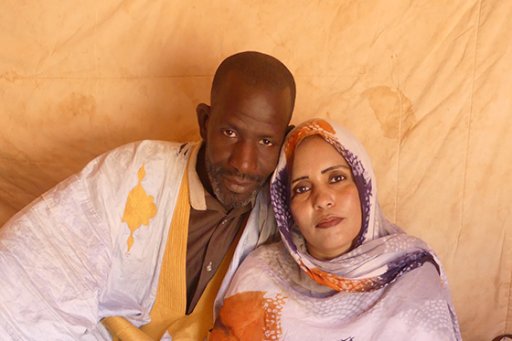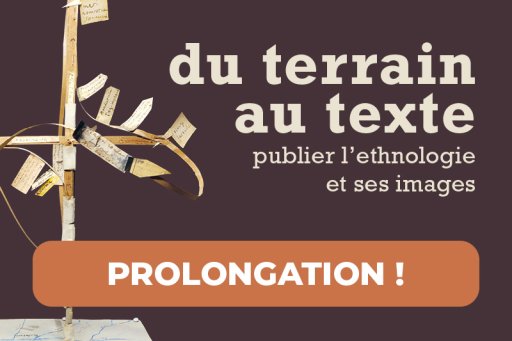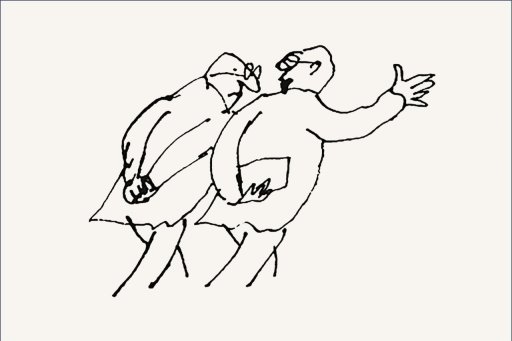Passionnée de physique quantique, Pascale Senellart veut mettre la lumière au service des technologies de demain. Ses recherches sur les boîtes quantiques semi-conductrices permettent de développer, grâce aux photons qu’elles génèrent, des outils de calcul et de communication quantiques.
En 2025-2026, elle est invitée à occuper la chaire annuelle Innovation technologique Liliane Bettencourt au Collège de France.
Comment est né votre intérêt pour la science, puis pour la physique ?
Pascale Senellart : Quand j’étais enfant et que nous rendions visite à mes grands-parents, nous passions toujours devant l’Observatoire radioastronomique de Nançay. C’est une structure immense et impressionnante, perdue au milieu de la nature, qui me fascinait beaucoup. Alors, je leur ai demandé de me prendre en stage en troisième, et j’ai été merveilleusement bien accueillie par les techniciens, ingénieurs et chercheurs, qui m’ont confié des tâches à la hauteur de mes capacités de l’époque. Pendant plusieurs années, j’y suis retournée plusieurs fois : d’abord pour faire de la soudure, puis de la programmation. La dernière année, quand j’avais 18 ans, ils m’ont appelée, car l’un des observateurs avait besoin d’être remplacé au pied levé pendant quelque temps. Je suis toujours aussi fascinée par les grands instruments qui illustrent comment l’ingénierie de haut vol permet l’exploration scientifique. Mais rapidement, j’ai compris que l’astronomie m’intéressait moins, car les objets qu’elle observe sont lointains et l’expérimentateur n’est pas en mesure de changer rapidement la façon d’interroger le système pour répondre aux questions qu’il se pose. Puis, j’ai découvert la mécanique quantique lors d’un oral pour intégrer l’École normale supérieure de Lyon. Des examinateurs, en me faisant réfléchir à ce qu’il se passe si un photon passe par deux fentes à la fois, m’ont éveillée à des notions absolument fascinantes. C’était un déclic. Je savais dès lors que je voulais me lancer dans ce champ de recherche.
Dès 2002, vos travaux vous amènent à l'intersection de l'optique quantique et des matériaux semi-conducteurs. Quels sont les enjeux de cette interface à l'époque où vous commencez à y travailler ?
Depuis les années 1980, on imagine que certaines nanostructures semi-conductrices – que l’on appelle des boîtes quantiques – peuvent se comporter comme un atome unique. La confirmation expérimentale est apportée au début des années 2000 avec la démonstration de l’émission de photons un par un par ces boîtes quantiques, mais c'était encore très balbutiant, très inefficace. Les photons étaient émis dans toutes les directions de l'espace, et n'avaient pas les propriétés quantiques recherchées. Une idée émerge alors déjà : pour collecter ces photons, il faut placer cette boîte quantique dans une cavité optique – une caisse de résonance qui rend bien plus directive la façon dont l’atome émet sa lumière. Les preuves de concept qui existent à ce moment-là impliquent cependant des ensembles d’émetteurs. Alors, pour parvenir à un émetteur unique, j’ai rédigé un projet CNRS assez ambitieux – ce que j’ignorais à l’époque, car, quand on débute dans le métier, on est toujours un peu naïf. Pour commencer, je voulais reproduire dans les matériaux semi-conducteurs des expériences très pures de la mécanique quantique, telles que celles qui ont été faites par Serge Haroche au Collège de France. Dans celles-ci, il envoyait des atomes un par un dans des cavités micro-ondes, démontrant un couplage très important entre un atome et un photon. Mon premier objectif, c'était de reproduire cela dans des matériaux semi-conducteurs où la physique est plus « sale », notamment parce que beaucoup d'atomes vibrent. Puis, je voulais voir à quel point je pouvais « nettoyer » ce système pour m'approcher d'un système modèle quantique très pur. En 2005, nous parvenions à démontrer ce couplage fort entre un atome et une cavité optique. Peu après, en 2007, j’inventais une technologie permettant de coupler une boîte quantique et une cavité optique de manière contrôlée – c’était un développement de technologie, qui a profondément changé notre façon de mener nos recherches par la suite.
Quelles perspectives la démonstration de ce couplage a-t-elle ouvertes ?
À partir du moment où nous possédions cet outil – et nous étions parmi les premiers au monde –, nous pouvions générer des photons intriqués de manière efficace et reproductible. Grâce à cela, dès 2010, nous avions fabriqué une des sources de photons intriqués les plus brillantes au monde. J'ai alors commencé à être contactée par des personnes qui essayaient de développer un ordinateur quantique ou de la communication quantique en exploitant des photons uniques ou des photons intriqués. En particulier, le Pr Andrew White de l’université du Queensland, à Brisbane en Australie, leader du domaine, trouvait notre travail formidable, et nous encourageait à aller encore plus loin. Il suggérait que nous produisions des photons indiscernables, c’est-à-dire qui possèdent une grande cohérence quantique et qui permettent de réaliser ce que l'on appelle des interférences quantiques. Cette propriété est au cœur de toutes les technologies quantiques à base de lumière. Voyez là comme une brique élémentaire qu'il faut absolument maîtriser afin d'utiliser des systèmes de photons. Cela représentait un défi supplémentaire : nous devions trouver une façon d'isoler notre petit émetteur des vibrations mécaniques, magnétiques et électriques qui sont naturellement présentes dans son environnement et de réussir à produire ces photons très identiques. En 2015, c’était fait ! Nous avions des photons très indiscernables, avec des composants fabriqués de manière systématique, reproductible, et dotés d’une efficacité record. Nous avions un pied dans le monde des technologies quantiques.
Comment s’est alors effectuée cette transition de vos travaux de recherche vers un monde d’applications technologiques ?
Nous apercevions dès lors les potentielles applications de nos composants dans le domaine du calcul quantique, des réseaux de communication quantique, et peut-être même un jour des capteurs quantiques, car la lumière est un outil véritablement versatile. En 2015, l’idée nous est venue de créer une start-up, car beaucoup de personnes souhaitaient collaborer avec nous et accéder à nos composants. Or, ceux-ci n’étaient encore qu’à l’état de prototype de laboratoire, et assez difficiles à utiliser. Nous voulions donc œuvrer à les rendre plus faciles à utiliser, et avons ainsi créé Quandela en 2017. Un collègue et ami, le Pr Khaled Karrai qui a créé en Allemagne la société Attocube, nous a guidés sur le volet commercial de ce projet, que je ne maîtrisais pas du tout. Ensemble, nous avons également discuté des points faibles et forts de la technologie et nous avons identifié les développements qu'il fallait stabiliser. Ce fut un travail de longue haleine, car nous devions tester la reproductibilité de notre technique et intégrer des sources dans des systèmes complets pour émettre des photons un par un. Les premiers composants livrés par Quandela étaient encore des objets de laboratoire, mais les premiers clients étaient motivés à apprendre comment les utiliser. Puis, récemment, nous avons sorti des sources de photons uniques très faciles d’usage, pour lesquelles l'utilisateur n'a besoin d’aucune connaissance technique préalable : tout est automatisé.
Comment le paysage des applications technologiques a-t-il évolué depuis le lancement de votre start-up ?
Quandela est l'une des premières start-up françaises de technologies quantiques. À son lancement, l'écosystème n’était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Nous avons dû expliquer les technologies quantiques à de nombreuses institutions de la valorisation française. À l’époque, il n'y avait pas un engouement très fort pour ce genre d'exercice, mais je suis très surprise de la vitesse à laquelle les choses ont évolué. J'étais une extraterrestre, quand on essayait de créer une start-up en 2015, et depuis, de nombreux chercheurs du quantique se sont lancés. C'est important, car nous sommes au cœur d’une course technologique internationale assez effrayante, dont les enjeux sont identifiés comme étant absolument souverains. En effet, un État ou une société qui aurait à sa disposition un processeur de calcul quantique dit « universel », avant les autres, pourrait perturber l'équilibre international, ayant à sa disposition des moyens de calculs inaccessibles aux meilleurs supercalculateurs actuels.
Que vous inspirent cette soudaine accélération au sein du milieu, cette émergence d’une certaine forme de concurrence internationale et les enjeux qui l’accompagnent ?
Notre monde a vraiment changé ces dernières années. Par exemple, on ne peut plus collaborer avec certains pays sur ces technologies, ce qui est très dommage et compliqué, dans le monde scientifique. Il y a aussi une forte émulation liée au fait qu'il existe plusieurs plateformes : on peut faire un ordinateur quantique avec des qbits supraconducteurs, des atomes, des composants silicium... Donc, il y a une bonne compétition scientifique, mais aussi beaucoup de fertilisation croisée, c'est-à-dire d'effets positifs d'une communauté sur l'autre. Un succès scientifique obtenu sur un système physique va en influencer d'autres, et parfois permettre de débloquer un verrou technologique dans une autre approche. Globalement, c'est très beau de voir cette grande communauté émerger à partir de plus petites communautés qui ne communiquaient pas entre elles auparavant. Il y a encore quinze ans, nous ne discutions pas beaucoup avec des chercheurs qui manipulent des atomes ou des qbits supraconducteurs, et maintenant nous sommes tous dans la même communauté. Nous avons assisté à un véritable décloisonnement des communautés de l'optique, des atomes froids, des supra et des semi-conducteurs – autant de secteurs techniques, où l'on manipulait les mêmes concepts sans vraiment en parler entre nous. Cette pluridisciplinarité est très féconde et absolument passionnante. Nous travaillons également avec les spécialistes des algorithmes quantiques pour les rendre plus adaptés à notre matériel ou encore avec des spécialistes de l'intelligence artificielle pour optimiser nos processeurs.
Vous accédez en 2025 à la chaire annuelle Innovation technologique Liliane Bettencourt au Collège de France. Que représente-t-elle pour vous et qu’en attendez-vous ?
Je suis très heureuse d'avoir été proposée pour enseigner au Collège de France. Au départ, je suis une directrice de recherche au CNRS, expérimentaliste, et mon mari et moi avons eu trois enfants assez tôt dans ma carrière. Je me suis donc mise assez tardivement à l'enseignement quand je me suis sentie en mesure de tout gérer en parallèle – il y a une douzaine d'années. Or, j'ai découvert qu'enseigner, c’est aussi et surtout apprendre. On ne peut partager que ce que l’on a compris en profondeur. Par le cours que j’ai construit, j’espère montrer la riche variété des systèmes quantiques, qui arrivent aujourd'hui dans cette course technologique passionnante. Je vais adopter une approche assez large pour ceux qui veulent comprendre ces technologies tout en présentant les dernières avancées du domaine et les enjeux à venir, avec le minimum de formalisme et d’outils. J'adore ce genre d'exercice : essayer de parler à plusieurs niveaux en même temps, c’est un des défis que j'aime beaucoup relever. Enfin, je suis très honorée d’apporter ma pierre à l’édifice, car le Collège de France a un historique de professeurs absolument remarquable.
Propos recueillis par William Rowe-Pirra, journaliste scientifique