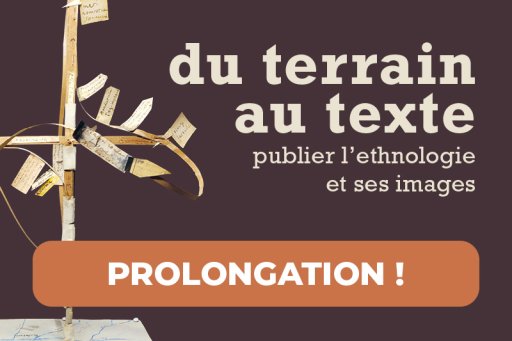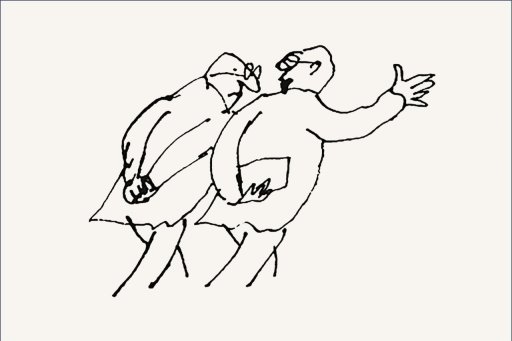Maria Melchior est spécialiste de l’étude de la santé mentale, en particulier celle des jeunes. Elle explique en quoi l’approche épidémiologique peut apporter de nouvelles connaissances sur la façon dont nous abordons cet enjeu à l’échelle de nos sociétés, et alerte sur l’urgence de mieux l’appréhender auprès de cette génération.
Chercheuse à l’Inserm, Maria Melchior est invitée, pour l’année 2025-2026, à occuper la chaire annuelle Santé publique créée en partenariat avec l’Agence nationale Santé publique France.
Les recherches en santé mentale s’intéressent en général à l’individu. Pourquoi avez-vous choisi de vous concentrer sur des populations ?
Maria Melchior : Un peu par hasard ! J'ai fait une partie de mes études de psychologie aux États-Unis, où les outils de mesure pour la recherche populationnelle et quantitative dans le champ de la santé mentale ont été imaginés et déployés. J’ai donc très tôt été formée à ces questions. En France, en revanche, l’épidémiologie psychiatrique a une place moindre. C’était d’autant plus vrai lorsque j’ai débuté mes recherches il y a vingt-cinq ans, même si les choses ont changé depuis. Toutefois, nous restons encore peu nombreux dans ce domaine. Comme nombre de médecins, psychologues, sociologues et économistes, je m’intéresse au sujet de la santé mentale chez les jeunes ; ma particularité en tant qu’épidémiologiste, c’est que j’utilise les statistiques afin d’établir la fréquence des troubles psychiques dans une population ainsi que les facteurs qui les causent. Pour y parvenir, je travaille sur des groupes de personnes suivis pour des besoins scientifiques, que l’on appelle des cohortes.
Je m'occupe, par exemple, de la cohorte TEMPO (Trajectoires Épidémiologiques en Population) qui inclut environ trois mille cinq cents personnes. TEMPO a été initiée en 1991, il y a plus de trente ans, par un collègue pédopsychiatre. Son objectif était de cartographier la fréquence de différents types de troubles de santé mentale chez les enfants et les motifs de recours aux soins, car nous disposions de très peu de données à l’époque. J'ai décidé de reprendre le suivi en 2009 avec l’idée que les participants étaient tous adultes. Je me suis dit que le fait de connaître l’état de santé mentale de ces adultes – quand ils étaient enfants et adolescents – était une richesse et pouvait expliquer certains phénomènes de santé mentale.
Que nous apprennent les résultats du suivi de ces cohortes ?
Tout d’abord, il faut savoir que chez les adultes, les études montrent qu’environ une personne sur cinq développera un trouble psychologique à un moment donné au cours de sa vie et que la prévalence des troubles de la santé mentale les plus fréquents, comme la dépression, est de l'ordre de 7 % à 8 % de la population, ce qui représente beaucoup de personnes.
Ce qui est plus marquant encore dans nos résultats, c’est que nous avons observé une augmentation des taux de symptômes dépressifs chez les adolescents et jeunes adultes : environ un jeune sur cinq, aujourd'hui, rapporte des symptômes dépressifs. En outre, la santé mentale des jeunes s’est dégradée depuis plusieurs années. C'est surtout, a priori, chez les adolescents les plus jeunes que nous observons des évolutions défavorables, notamment les filles. L’autre particularité, c’est que, comme chez les adultes, la pandémie de Covid-19 a été une période compliquée sur le plan de la santé mentale. Mais chez les jeunes, contrairement aux adultes qui ont vu leur santé mentale s’améliorer dès la fin de la pandémie, il n’y a pas eu de diminution de ces symptômes. Chez les adolescents, nous restons à des taux très élevés et nous ne savons pas comment les choses vont évoluer ces prochaines années.
Comment explique-t-on une telle dégradation de la santé mentale chez les plus jeunes ?
L’épidémie de Covid a marqué un tournant. Pendant les confinements, toute une génération d’adolescents s’est retrouvée privée de cours en présentiel et de vie sociale, sans l’avoir choisi. Or, pour les adolescents, le fait d'avoir des contacts avec leurs copains, de pouvoir s'extraire du milieu familial est particulièrement important en matière de santé mentale.
Comme je l’ai évoqué précédemment, ce mal-être n’a pas disparu avec la fin des restrictions. Le Covid n’est pas le seul responsable : d’autres facteurs entrent en jeu, comme l’augmentation du temps passé devant les écrans, une tendance déjà présente avant la crise, qui s’est considérablement amplifiée depuis. Un adolescent moyen passe désormais entre cinq et six heures par jour devant un écran. C'est devenu une partie très importante de leur vie, cependant, ce temps se prend aux dépens d'autres activités, en particulier le sport, la lecture et les activités de groupe. Pour de nombreux jeunes, ce changement dans les formes de sociabilité ne pose pas de problèmes, mais, pour certains, le monde virtuel en vient à remplacer d’autres formes d’interactions qui sont pourtant nécessaires. L’autre revers de cette consommation des écrans est la surexposition à un flot continu d’informations. Guerre en Ukraine, crise au Moyen-Orient, crise climatique… Nos adolescents sont très informés sur ce qui se passe dans le monde, beaucoup plus que les générations précédentes, dans un monde qui semble incertain à beaucoup d’adultes. C’est une source d’inquiétude pour eux aussi.
En quoi le contexte économique, par exemple l’inflation, a-t-il également un impact sur la santé mentale des plus jeunes ?
En France, comme ailleurs, la pauvreté et les inégalités de revenus ne cessent d’augmenter, et cela a des conséquences directes sur les plus jeunes et leurs familles, les familles monoparentales étant particulièrement touchées alors qu’elles représentent une famille d’adolescents sur quatre en France. Lorsque leurs foyers sont confrontés à un stress intense ou à des difficultés financières, les jeunes en subissent les répercussions. Par exemple, un certain nombre d'études sur la précarité alimentaire, qui se traduit par le fait de ne pas avoir de moyens financiers suffisants pour se nourrir correctement et de manière équilibrée, montrent qu’elle est un facteur de risque à part entière et qu’elle génère des problèmes d'anxiété chez les plus jeunes.
Plus largement, les contraintes matérielles sont une source importante de stress pour eux. Or, nous vivons dans une société où la précarité de l'emploi est forte, surtout pour les jeunes. C'est-à-dire que là où les générations précédentes pouvaient espérer un CDI au moment d'accéder à un premier emploi, à l’heure actuelle, ce n'est plus du tout la norme. Le marché de l'emploi s'est énormément déstructuré, ce qui est une source d’angoisses et a des effets sur leur intégration sociale. Ces derniers ont plus de mal à trouver un logement. La précarité énergétique, c’est-à-dire les difficultés à payer son loyer et son chauffage, est également un poids mental. Plus largement, il y a des recherches sur l'évolution des modes de conjugalité qui montrent que, tant que l'on n'a pas un emploi stable qui permet de partir de chez ses parents, de s'autonomiser, on ne s'installe pas en couple et on ne peut pas se projeter.
Vous avez aussi beaucoup travaillé sur la dépression post-partum. Quel lien y voyez-vous avec la santé mentale des jeunes ?
Grandir avec un parent dépressif, qu’il s’agisse de la mère ou du père, expose l’enfant à des risques accrus de problèmes de santé. La période du post-partum est particulièrement critique en matière de santé mentale pour la mère, puisqu’une femme sur cinq développe un trouble dépressif dans l’année qui suit l’accouchement. Pour près de la moitié d’entre elles, ces symptômes risquent de persister ou de recommencer plus tard, avec des conséquences directes sur leur capacité à s’occuper de leur enfant. Par exemple, on observe que les enfants de mères dépressives sont moins bien suivis sur le plan médical : moins de vaccinations, retards dans les soins, etc. Ils ont un risque élevé de surpoids, car la dépression peut aussi affecter la capacité des parents à gérer l’alimentation familiale.
Même si la question de la santé mentale périnatale est aujourd’hui mieux reconnue, notamment grâce à la stratégie des mille premiers jours, il reste des lacunes dans l’accès aux soins pour les personnes souffrant de dépression post-partum. Il faut aussi noter que les actions existantes sont largement focalisées sur les femmes alors que les hommes peuvent aussi avoir des difficultés psychologiques et des conduites addictives plus fréquentes autour de la naissance d’un enfant, mais qui ne sont pas actuellement repérées, prises en charge de manière systématique. Une piste encourageante réside dans le congé paternité, qui aurait des effets bénéfiques sur la santé mentale des pères et des enfants, en revanche, plus limités sur celle des mères.
Comment améliorer nos politiques publiques afin de mieux prendre en charge la santé mentale des plus jeunes ?
Il faut déployer des actions de prévention et d’accompagnement accessibles à tous. Des dispositifs comme « Mon soutien psy », qui permet le remboursement de douze séances chez un psychologue agréé, peuvent permettre de faciliter l’accès aux soins de première intention. Il y a aussi des lignes téléphoniques comme le 31-14 pour la prévention du suicide, le 31-18 pour les adolescents victimes de harcèlement ou encore le « Fil Santé Jeunes », avec un chat pour les jeunes en difficulté. En cas de crise, comme une tentative de suicide chez un adolescent, le système est conçu pour réagir rapidement, même si souvent, ces crises surviennent après une longue période de mal-être. L’objectif est d’agir avant que la situation ne s’aggrave.
Il y a, en outre, toute une vigilance à développer en milieu scolaire. Chez les jeunes, le stress lié à la réussite scolaire est un enjeu critique. Les tentatives de suicide augmentent pendant les périodes de cours, en raison de multiples facteurs, dont la pression académique, les situations de harcèlement et des tensions qui peuvent être amplifiées par les réseaux sociaux. Les programmes comme « Phare », qui vise à désigner des référents contre le harcèlement dans les établissements, demeurent insuffisamment évalués quant à leur efficacité et leur application peine à être généralisée. Ceux de renforcement des compétences psychosociales ont, par contre, montré une grande efficacité chez les enfants et adolescents. Déployés dès l’école maternelle, ils aident les enfants à mieux identifier et gérer leurs émotions, à résoudre les conflits de manière constructive et à éviter l’isolement. Ces programmes apprennent aux enfants à mieux communiquer et à réagir face à des situations pouvant être source de mal-être, réduisant ainsi les risques de souffrance psychologique. Cependant, ces initiatives restent marginales dans les cursus scolaires, faute de temps, de moyens et de formations adéquates pour les enseignants et les autres acteurs de l’éducation.
Propos recueillis par Emmanuelle Picaud, journaliste scientifique