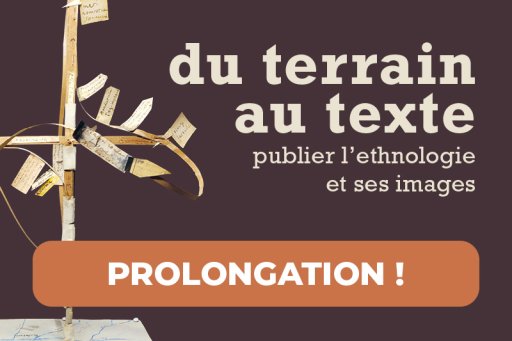Biologiste, Virginie Courtier-Orgogozo étudie les mécanismes génétiques impliqués dans l’évolution, afin de mieux comprendre les origines et l'avenir des espèces, avec une approche aussi scientifique que philosophique. Elle travaille aussi sur une biotechnologie expérimentale, le forçage génétique, dont elle évalue les risques à court et long termes.
Elle est invitée sur la chaire annuelle Biodiversité et écosystèmes, qui bénéficie du soutien de la Fondation Jean-François et Marie-Laure de Clermont-Tonnerre.
Comment est né votre intérêt pour l’évolution des espèces et ses mécanismes sous-jacents ?
Virginie Courtier-Orgogozo : Depuis toujours, je ressens cette envie de comprendre le monde vivant. À quinze ans, j’avais emprunté un microscope à mon professeur de SVT pour les vacances d’été et je m’émerveillais devant les microorganismes. Bien évidemment, cela m'a conduite sur le chemin de la recherche. Pendant ma thèse, j’ai étudié les mécanismes moléculaires et cellulaires par lesquels des organismes complexes se développent à partir d'une seule cellule. Ensuite, j’ai commencé à m’intéresser à l’évolution et, après ma thèse, j’ai choisi d’utiliser l'approche génétique pour essayer de mieux comprendre les mutations qui apparaissent et sont responsables des changements de traits de caractère. Je voulais voir si l’on pouvait raffiner la théorie de l’évolution, en y incluant ces gènes et ces mutations. Dans les années 2000, on connaissait déjà quelques génomes. Puis les techniques de génomique se sont développées, par exemple avec le séquençage haut débit, ce qui a engendré une explosion de découvertes sur les gènes et les mutations. On savait déjà que l'évolution se répète souvent à différents endroits du globe. Ainsi, dans les milieux enneigés, on observe des pelages blancs chez différentes espèces. En étudiant les génomes, il est apparu que cette convergence de traits résultait souvent de mutations dans les mêmes gènes, qui apparaissaient indépendamment chez des espèces ou des populations différentes. L'évolution se répète non seulement à l'échelle des traits de caractère, mais elle emprunte aussi un nombre limité de chemins génétiques. Cela signifie que, dans un génome, il n'y a pas autant de possibilités qu'on pourrait l’imaginer pour évoluer vers une forme donnée. Tout un pan de l'évolution, qu'on pensait très aléatoire, s'avère en fait assez répétitif.
Si l’évolution emprunte un nombre limité de « chemins génétiques », cela implique-t-il, comme l’évolutionniste anglais Simon Conway Morris le suggérait, que, même avec des conditions initiales différentes, l’évolution suivrait un chemin similaire ?
Quand j'ai commencé mes recherches, j'étais plutôt proche des idées du paléontologue américain Stephen Jay Gould qui pensait, au contraire, que l’évolution comporte de nombreux phénomènes aléatoires imprévisibles et que l’espèce humaine est un pur produit du hasard. Pour lui, rien ne prédisposait les ancêtres des humains à réussir. D'autres groupes d’espèces auraient très bien pu acquérir une position dominante sur Terre, à notre place. Il s'était intéressé à la faune de Burgess, et notamment aux petits fossiles de Pikaia gracilens, précurseurs des vertébrés ayant l’aspect d’une anguille, qui n'avaient rien de particulier les différenciant des autres animaux de leur époque. Ce qui est intéressant est que Simon Conway Morris, paléontologue anglais reconnu, a étudié les mêmes fossiles que Gould et est arrivé à une conclusion diamétralement opposée. L’évolution de la vie est un processus qui ne s'est produit qu'une seule fois sur Terre. On peut se demander si, dans d'autres conditions, elle aurait donné la même chose. C'est une expérience de pensée intéressante, mais, fondamentalement, nous n'en savons rien. Pour Morris, sur d'autres planètes, si les conditions sont réunies pour que la vie évolue, on retrouvera des arbres qui formeront comme chez nous des forêts vertes. En effet, pour capter l'énergie lumineuse, il y aura de la compétition entre les êtres vivants. Donc, les plus hauts domineront et formeront des troncs. Les feuilles existeront également, car elles maximisent la surface d’absorption de la lumière. Et elles seront vertes parce que c’est la couleur de la molécule la plus à même de capter cette énergie lumineuse : la chlorophylle… Se demander si l’évolution suivrait un chemin similaire, si on la relançait avec des conditions initiales légèrement différentes, est avant tout une question philosophique, mais c’est aussi une question qui présente des aspects pratiques : pour chercher et détecter d’autres formes de vie dans notre univers, il est nécessaire d’imaginer à quoi pourrait ressembler la vie ailleurs.