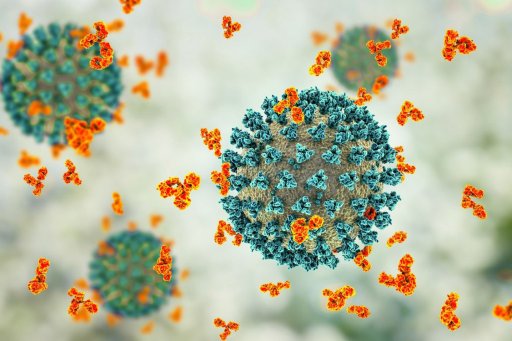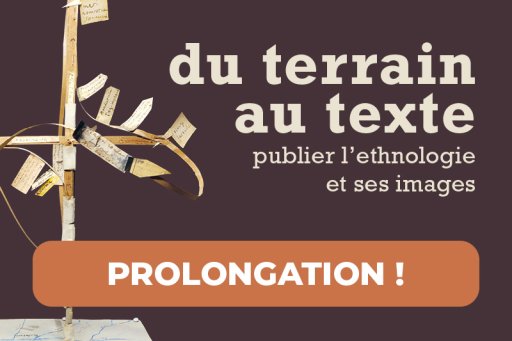En 2019, Google annonçait avoir atteint ce que le physicien américain John Preskill a baptisé la « suprématie quantique ». Avec son processeur quantique Sycamore, le géant américain est en effet parvenu à résoudre un problème qu’aucun ordinateur classique n’aurait pu résoudre en un temps raisonnable. Même si ce problème n’avait a priori aucune application réelle, cette avancée technologique a fait forte impression dans la communauté des physiciens et des informaticiens. Pour autant, ce prototype est encore loin d’être suffisamment puissant pour être considéré comme un ordinateur quantique. Cela n’empêche pas les informaticiens théoriciens d’anticiper ce qui pourrait survenir avec l’arrivée d’une telle machine en imaginant de nouvelles idées algorithmiques. En France, Frédéric Magniez est un leader de cette recherche. Diplômé de l’ENS Cachan, agrégé de mathématiques et docteur en informatique théorique, il dirige depuis 2018 l’Institut de recherche en informatique fondamentale (IRIF). Ses travaux portent sur la conception et l’analyse d'algorithmes probabilistes pour le traitement des grandes masses de données, ainsi que sur le développement de l'informatique quantique et plus particulièrement la cryptographie et ses interactions avec la physique.
Il occupe la chaire annuelle Informatique et sciences numériques du Collège de France, dédiée cette année aux algorithmes quantiques.
Dans la chaire d’informatique que vous occupez cette année au Collège de France, vos cours portent sur l’informatique quantique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste ce champ de recherche ?
Frédéric Magniez : Lorsque de nouvelles architectures informatiques font leur apparition – par exemple un supercalculateur – un nouveau modèle de calcul émerge et la communauté des informaticiens théoriciens, dont je fais partie, essaie d’en comprendre les implications. Notamment nous nous demandons si l’on peut programmer ces machines, si l’on peut mettre au point des algorithmes qui tirent parti des spécificités de cette nouvelle architecture. Mais l’on se demande aussi ce que cela change en termes de complexité et de ressources. Par exemple, est-ce qu’un problème auparavant difficile peut devenir simple ? Le calcul peut-il être accéléré ? Dans le cas de l’informatique quantique, on se pose toutes ces questions avec une architecture bien particulière : un ordinateur quantique.
Qu’est-ce qu’un ordinateur quantique exactement ?
Il s’agit d’une machine qui repose sur les lois de la mécanique quantique pour stocker et manipuler de l’information. Contrairement à un ordinateur classique qui manipule des bits d’information (des 0 ou des 1), un ordinateur quantique manipule ce que l’on appelle des bits quantiques – ou qubits. Ces derniers peuvent être dans l’état 0 ou 1 mais aussi dans une superposition de ces états. Pour certains types de problèmes, cette propriété de la mécanique quantique permet d’accélérer significativement la vitesse de calcul. C’est le cas par exemple pour la factorisation, l’opération inverse de la multiplication. S’il est très simple de multiplier deux nombres entiers très grands, la factorisation, qui consiste à décomposer un très grand nombre en le produit de ses facteurs, est beaucoup plus complexe. Tellement complexe en fait que nos ordinateurs classiques sont incapables d’exécuter ce calcul en un temps raisonnable. Or, avec un ordinateur quantique, ce calcul serait exponentiellement plus rapide. Et donc possible, en théorie.
En théorie ?
Oui, car l’ordinateur quantique universel n’existe pas encore. Seuls des prototypes de calculateurs quantiques ont été mis au point, notamment par Google et IBM. Pour donner un ordre de grandeur, un ordinateur classique est doté de processeurs de plusieurs milliards de bits (0 ou 1) quand les prototypes quantiques manipulent moins d’une centaine de qubits. Le prototype Sycamore de Google, par exemple, possède seulement 53 qubits. Par ailleurs, ces prototypes sont sujets à des erreurs de calculs, ce qui rend impossible l’exécution d’algorithmes quantiques vraiment utiles.