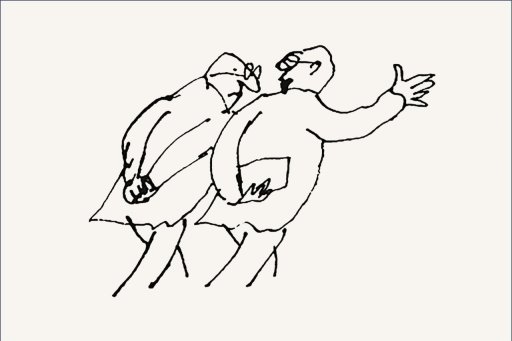Entretien avec Laurent Coulon

Titulaire de la chaire Civilisation de l’Égypte pharaonique au Collège de France, Laurent Coulon démontre par ses travaux et son engagement combien l’égyptologie est une science vivace.
Comme égyptologue, vous plaidez pour une égyptologie « ouverte ». Comment pourrait-on définir l’égyptologie, et que mettez-vous dans ce terme « ouverte » ?
Laurent Coulon : Le mot « égyptologie » a été créé au XIXe siècle et se définit par un objet bien délimité : l’étude de l’Égypte de la civilisation pharaonique, de la fin du IVe millénaire avant J.-C. à l’époque romaine, au IVe siècle après J.-C. C’est la durée de vie du modèle de la royauté pharaonique et de l’écriture hiéroglyphique. L’égyptologie a chez nous une résonance sociétale particulière, liée à la fascination qu’exerce l’Égypte ancienne ; elle peut dès lors apparaître comme une discipline singulière. Je m’appuie sur la tradition des savants illustres qui l’ont nourrie, mais je prône aussi une approche comparatiste des phénomènes égyptiens : il faut que toutes les sciences humaines, l’histoire, l’anthropologie, l’histoire de l’art, la littérature, la philosophie puissent se saisir de ce matériau.
Pourquoi avoir choisi l’égyptologie ? Quelles étaient vos motivations à l’origine ? Quelles sont-elles aujourd’hui ?
Nombre d’égyptologues ont été fascinés dès l’enfance par l’Égypte ancienne, par le biais de lectures, d’expositions, de cours. Cela n’a pas été mon cas. J’ai suivi une formation littéraire, jusqu’à l’agrégation de lettres classiques. Au cours de ces études, en arrivant à Paris, j’ai découvert d’autres horizons. J’ai suivi des enseignements très divers à la Sorbonne et à l’École normale supérieure, et j’ai été attiré par la littérature égyptienne et la modernité de ses œuvres, qui semblaient peu connues. Par ailleurs, j’ai eu la forte impression que l’égyptologie offrait la possibilité de se confronter à une vaste documentation inédite, des sources non exploitées. Le contact avec le terrain égyptien, notamment comme coopérant pour mon service militaire en Égypte sur le site de Karnak, m’a renforcé dans mon choix.
Avec le recul, la motivation liée à la possibilité de nouvelles découvertes est restée intacte. En 1993, quand je suis arrivé à Karnak, le centre franco-égyptien venait de découvrir un tombeau d’Osiris, qui était le premier exemplaire de catacombes de ce type. Depuis, au moins deux autres tombeaux similaires ont été trouvés. Cela signifie qu’en trente ans, notre connaissance du culte d’Osiris a été révolutionnée par ces nouveaux matériaux, c’est assez exceptionnel ! Autre exemple : avec mon collègue Philippe Collombert, nous avons réussi à retrouver le début du papyrus d’Astarté, un récit importé du Proche-Orient, en connectant la partie connue à un fragment de papyrus daté du pharaon Amenhotep II, qui se trouvait… à la BnF. Grâce à ces recherches, c’est toute une page de la littérature égyptienne qui a été réécrite ! Un de mes collègues a coutume de dire qu’on est égyptologue quand on est capable de publier un document inédit, c’est une tâche indispensable pour qui veut véritablement se confronter à la complexité égyptienne !
Au-delà de cet aspect, la volonté de transformer ces données en discours accessible à d’autres chercheurs m’anime fortement. On peut parfois avoir l’impression, à lire les anthropologues notamment, que l’Égypte constitue un point aveugle ou laissé de côté, tant le matériau est abondant ou peu « préparé » aux questionnements comparatistes. Certaines rencontres ne se sont pas produites, peut-être par la faute des égyptologues. L’exemple égyptien doit jouer un rôle plus important dans ces analyses comparées.
Une part importante de vos travaux est consacrée à la religion égyptienne. Quelles sont ses grandes spécificités ?
La religion égyptienne est un polythéisme « comme les autres », si l’on peut dire : son fonctionnement se fonde sur une diversité de dieux, à laquelle s’ajoute une diversité géographique. Chaque ville d’Égypte avait un dieu local, associé à une triade (le dieu – son conjoint – leur enfant). Autour de ce noyau, les théologiens développaient des cosmogonies mettant leur localité au centre du monde. Dans ce paysage varié, il y avait bien sûr des constantes, notamment un schéma récurrent pour le processus de la création. Pour les Égyptiens, l’Univers naissait d’une étendue incréée d’où émergeait un démiurge qui donnait à son tour naissance à des groupes de dieux, fondant les bases de la vie religieuse.
Par ailleurs, les pratiques rituelles jouent en Égypte ancienne un rôle essentiel. Le rite est ce qui organise le rapport entre les hommes et les dieux, c’est une sorte de contrat entre l’humanité et le monde divin : si les rites ne sont pas correctement effectués, à la bonne fréquence, toute la société des hommes est en péril. Le ritualiste en chef est le roi pharaon, il est l’intermédiaire privilégié dans la « maison du dieu ». Car, dans la conception égyptienne, après un temps mythique où les hommes et les dieux cohabitaient, il y a eu rupture de ce modus vivendi et les dieux se sont retirés dans le ciel. Dès lors, le seul point de contact possible avec eux est devenu le temple, à travers l’image divine située au fond du sanctuaire. Le rôle des images est ainsi fondamental dans la religion égyptienne, c’est le medium qui permet de communiquer avec les dieux. Enfin, ce qui fascine, et peut-être déroute, c’est l’apparence de la plupart des dieux égyptiens, à corps humain et à tête animale. L’animal peut également jouer le rôle d’intermédiaire avec le divin.
Vous vous intéressez plus particulièrement au culte d’Osiris, ce qui vous a amené à mieux caractériser cette religion égyptienne. Pourquoi ?
Ce qui est particulier avec le culte d’Osiris, c’est que l’on peut le voir naître et évoluer dans le temps sur presque toute la période pharaonique. Il peut donner aussi l’image d’un dieu « à part », par son apparence humaine et son destin de dieu mortel. Ce qui m’a intéressé tout particulièrement, c’est ce que l’on peut appeler « l’osirianisation » de la religion égyptienne. À partir de la fin du IIe millénaire, le dieu Osiris s’intègre progressivement dans le paysage religieux et on retrouve le couple Osiris-Isis (sa sœur et épouse) dans tous les sanctuaires. Le mythe osirien est utilisé pour fédérer les territoires de l’Égypte, au profit du pouvoir politique, mais sans nier pour autant leur diversité. La présence de reliques d’Osiris à différents endroits, comme autant de parties de son corps démembré selon le mythe, montre la reconnaissance de chacune de ces religions locales. Autrement dit, le « phénomène osirien » n’est pas un pas vers un monothéisme, mais une dimension qui s’ajoute au polythéisme, c’en est une vision unifiée qui soutient le mythe politique de la royauté pharaonique. Une autre évolution intéressante est que le pharaon, traditionnellement associé à Horus, l’héritier d’Osiris, va peu à peu être identifié à Osiris lui-même dans l’idéologie pharaonique.
En outre, ce que j’ai contribué à éclairer, c’est le phénomène de la démultiplication des formes d’Osiris, de ses représentations, correspondant à des fonctions censées répondre à des besoins concrets de la population. À chaque forme d’Osiris est affecté un nom spécifique lui associant un pouvoir, dans un lieu défini. Osiris a ainsi été considéré comme dieu « sauveur » : on lui adresse des prières particulières pour une naissance ou pour lutter contre une maladie. Osiris, maître du royaume des morts, investit le territoire des temples, des divinités terrestres, et non plus seulement celui des nécropoles. Ces lieux qui lui sont consacrés dans les temples jouent le rôle de sas vers un au-delà osirien. Les rapports des vivants à Osiris deviennent plus visibles, son rôle acquiert une nouvelle dimension dans la société.
Que reste-t-il à découvrir sur la religion égyptienne ? Quelles sont les sources disponibles ?
Il y a encore beaucoup de textes sur papyrus qui apportent des données nouvelles sur les déclinaisons religieuses locales, dans des régions encore peu connues. D’un point de vue archéologique, il y a énormément de lieux de culte à découvrir. On a aussi beaucoup encore à analyser sur le statut des images osiriennes, c’est le sujet sur lequel je fais porter une partie de mes recherches. Les différentes images d’Osiris, comme le pilier Djed ou le « fétiche » d’Abydos, ont souvent été interprétées comme des motifs interchangeables du dieu. Or elles ont une histoire et sont associées à des spécificités cultuelles, lors de cérémonies particulières, qui doivent être contextualisées sur une longue durée pour mieux comprendre ensuite pourquoi elles sont utilisées dans tel ou tel environnement.
Du côté des sources, aux textes et à l’iconographie s’ajoutent les vestiges archéologiques et le mobilier, même dépourvu de toute inscription, que l’on retrouve dans les fouilles. À Karnak, dans la chapelle d’Osiris Ounnefer (maître des aliments), nous avons découvert une jarre en céramique positionnée en fondation de l’édifice. En la rapprochant d’images de jarres figurant sur des papyrus rituels provenant d’Abydos, j’ai pu démontrer qu’il s’agissait d’un modèle spécifique, sans caractère utilitaire apparent, mais lié aux besoins du culte. Une hypothèse que j’ai pu faire valider par une spécialiste de la céramique. C’est tout le sens des équipes interdisciplinaires : on ouvre de nouvelles perspectives en apportant une vision concrète des pratiques cultuelles qui étaient mises en œuvre.
L’autre volet de vos recherches concerne la rhétorique égyptienne, dont vous avez montré l’importance. De quelle façon ?
En qualifiant l’Égypte ancienne de « civilisation de l’écrit », on a souvent occulté une dimension importante, qui est celle de l’art oratoire. Les textes littéraires, mais aussi les textes officiels inscrits sur les monuments pharaoniques, témoignent de ce rôle essentiel du discours : y sont mis en scène les décisions du pharaon sous forme de dialogue entre lui et ses courtisans, et le pouvoir et les qualités du discours y sont souvent soulignés. On mesure l’importance de la rhétorique également à la lecture des épithètes laudatives des stèles funéraires. Quand on fait l’éloge d’un défunt, il est courant de pointer son éloquence, la justesse de sa parole. Dans une société de cour comme la royauté pharaonique, c’est un des moyens de se distinguer et d’obtenir la faveur royale, essentielle. On assiste à une double valorisation : du silence (il faut savoir se taire, contrôler ses émotions), mais aussi de la parole (avoir la formule qui arrive à point nommé, ce que les Égyptiens appellent le « tjes », le « nœud »). Inversement, comme le dit une sagesse égyptienne, « un lapsus à la cour c’est comme un mauvais coup de gouvernail en mer. »
Plusieurs œuvres littéraires révèlent, en outre, que les Égyptiens avaient perçu le décalage entre le discours et la réalité, contrairement à la vision naïve qui est répandue. On a longtemps prétendu en effet que, pour les Égyptiens, le mot était égal à la chose, comme s’ils pensaient que la magie régissait tout ; que prononcer un mot suffisait à faire exister la chose qu’il désigne. Ce n’est vrai que dans certains contextes et la rhétorique a précisément été conçue par eux comme un mode d’exploitation du décalage entre réalité et discours. Le rapport des Égyptiens à la vérité était donc complexe. Cette réflexion sur le discours, son usage à des fins politiques étaient présents bien avant l’essor de la civilisation grecque.
Quels liens peuvent être établis entre l’égyptologie que vous pratiquez et le monde contemporain ? Que nous dit l’égyptologie à nous, femmes et hommes du XXIe siècle ?
L’Égypte ancienne est partout dans la société contemporaine : dans les musées, la pop culture, les magazines… Cette civilisation est très présente dans notre quotidien, surtout en France où la passion pour la terre des Pharaons est ancienne et ancrée. Cela crée un intérêt partagé qui porte les études égyptologiques. Cela ne va pas sans malentendus ni querelles d’identité, quand certaines communautés essaient de s’approprier le passé. L’approche historique et anthropologique fondée sur des sources est la clé pour échapper à ce type de discours. Pour ma part, j’aime aussi percevoir comment la civilisation égyptienne a défini des modes de représentation du monde qui lui sont propres, mais aussi ses traits universalisables, ou en tout cas qui laissent observer certains mécanismes encore à l’œuvre dans notre société d’hier ou d’aujourd’hui. Je pense aux pratiques de la société de cour, que l’on peut rapprocher de celle de Louis XIV, ou à la manière de construire la rhétorique de certains discours.
Il est amusant de retrouver aujourd’hui des modes d’expression, déjà à l’œuvre il y a 4 000 ans. Il n’est pas rare de lire de la part d’une personne haut placée, le type de discours suivant : « Quand je suis arrivé aux affaires, j’ai trouvé tout à sac, et tout a été remis en ordre grâce à mon action ! » sans oublier les « protestations de véracité » : « Ce que je vous dis est véridique, il n’y a là aucun mensonge ! » Les historiens sont bien désemparés pour mesurer la part de réalité et d’exagération dans ces propos ! Cette rhétorique de l’homme providentiel ne peut pas s’entendre sans sourire quand on pense aux discours politiques de notre époque.
À travers plusieurs projets, comme LEAD*, vous vous êtes engagé en faveur des humanités numériques pour l’égyptologie. Quels sont les enjeux ?
Depuis deux siècles, l’égyptologie accumule une quantité phénoménale de données. En Égypte, ce sont plus de deux cents équipes de recherche internationales qui se déploient sur le terrain chaque année. Rien que les objets collectés se comptent par milliers. On ne peut conserver et exploiter ces données sans l’outil informatique. Mais si le numérique permet d’inventorier et de mettre à disposition d’immenses quantités de documents, c’est à condition d’avoir des référentiels communs de description et d’inventaire, afin de créer des corpus les plus complets et lisibles possibles. L’enjeu est également de rendre ces données ouvertes et partageables. C’est ce que nous nous appliquons à faire dans la base de données LEAD, qui prévoit de mettre en ligne le corpus raisonné de l’ensemble de la statuaire privée d’époque tardive.
Vous avez dirigé, jusqu’à septembre 2023, l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO), au Caire. Le contexte de demande de rapatriement d’œuvres égyptiennes vers l’Égypte depuis une dizaine d’années impacte-t-il la recherche égyptologique ?
J’ai confiance dans la volonté de dialogue de part et d’autre. Avec trente-cinq missions actives par an, la coopération franco-égyptienne en égyptologie se passe de façon très positive. Si ces missions peuvent être conduites, c’est parce que le ministère du Tourisme et des Antiquités égyptien permet l’accès au terrain. Avec mon équipe à l’IFAO, j’ai cherché parallèlement à développer la formation des archéologues et égyptologues égyptiens. Nous tentons ainsi de créer un cadre commun, qui permet des objectifs de recherche et de préservation du patrimoine partagés.
Propos recueillis par Catherine de Coppet