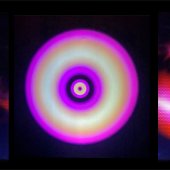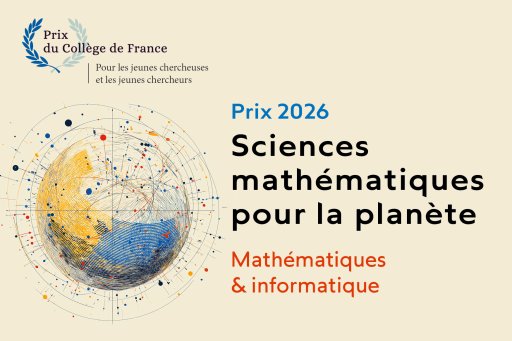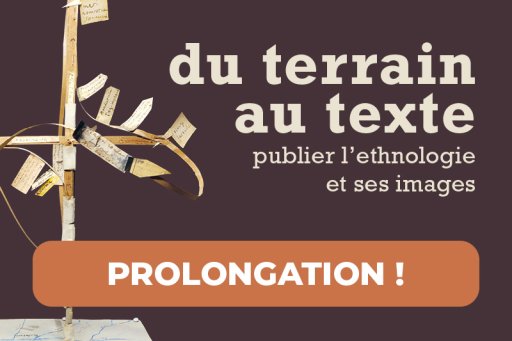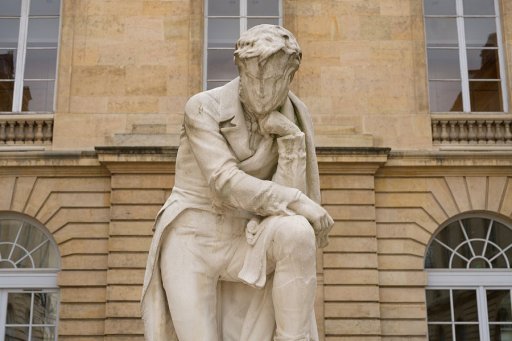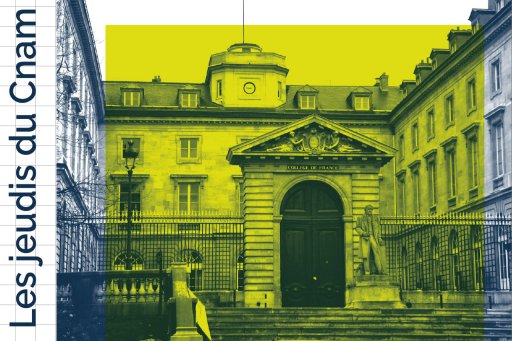La physique quantique bouleverse nos conceptions classiques du réel. Afin de permettre au plus grand nombre d’appréhender cette révolution scientifique, l’exposition L’Atelier quantique engage un dialogue inédit entre science, art et philosophie. Cette démarche interdisciplinaire pose une question fondamentale : peut-on représenter ce monde invisible décrit par la physique quantique sans en trahir la nature ?
Rencontre avec Aurore Young*, physicienne au Collège de France et commissaire scientifique de l’exposition.
Fortement mathématisée, la physique quantique est une science qui décrit des particules microscopiques dont le comportement réel reste inaccessible à nos sens. Le langage mathématique, bien qu’essentiel aux chercheurs, accentue cette difficulté pour le grand public à comprendre la discipline et à se saisir de ses enjeux. Dans ce contexte, certaines initiatives visent à réactiver les liens entre les savoirs et les sensibilités. C’est à cette ambition qu’aspire L’Atelier quantique, une exposition au Collège de France conçue pour permettre au plus grand nombre d’appréhender quelques concepts de la physique quantique, une discipline souvent perçue comme aussi fascinante qu’inaccessible, où se conjuguent abstraction mathématique, étrangeté conceptuelle et éloignement du sensible.
À l’origine du projet, une connivence amicale. « Une amie de classe préparatoire, Caroline Delétoille, devenait artiste peintre au moment où je reprenais des études, raconte la physicienne Aurore Young. Puis c’est en rencontrant Céline Boisserie-Lacroix, philosophe et spécialiste des échanges entre sciences et arts plastiques, que nous avons pensé que l’art serait une porte d’entrée intéressante à la physique quantique ». De cette rencontre est née l’idée d’une exposition commune, présentée au printemps 2025 sous le nom Sensation quantique à l’institut Henri-Poincaré. L’exposition reprend vie cet automne dans une version revisitée au Collège de France, L’Atelier quantique, et au Centquatre-Paris, chacun des deux lieux mettant en lumière une facette complémentaire du projet initial.
Cette idée ambitieuse repose sur la nécessité de « trouver un langage commun entre la philosophie, l’art et la science », une tâche que toutes les trois reconnaissent comme l’un des défis majeurs du projet. Loin d’un simple exercice de vulgarisation, L’Atelier quantique explore les conditions de traduction d’un monde mathématique vers un monde sensible, sans trahir la rigueur scientifique. Il s’agit de « passer par l’émotion, pour attiser la curiosité du visiteur, et l’amener ensuite à lire les panneaux de médiation », résume Aurore Young.
Doctorante au sein du Laboratoire Kastler-Brossel, Aurore Young travaille à la frontière de la théorie et de l’expérimentation. Chaque jour, elle interagit avec des dispositifs optiques d’une extrême précision, destinés à piéger des atomes à l’aide de lasers et à les placer dans des états quantiques particuliers. « Nous mettons les atomes proches les uns des autres, puis nous les envoyons dans un état dit de Rydberg afin de regarder comment ils interagissent », explique-t-elle. L’objectif est de créer une forme de « matière synthétique », permettant de simuler les comportements de matériaux réels, et de mieux comprendre des phénomènes encore mal maîtrisés, comme la supraconductivité, définie par l’absence de résistance électrique dans certains matériaux. Or, si la rigueur expérimentale est au cœur de cette recherche, la nature même des objets quantiques empêche toute appréhension directe. La physicienne rappelle que « de dire d’un objet qu’il est dans une superposition d’états, c’est une manière mathématique de le décrire, mais on ne peut jamais l’observer tel quel. À chaque mesure, nous perturbons le système ». Cette invisibilité constitutive est le point de bascule par lequel l’art peut interroger la science en explorant des formes de représentations métaphoriques des concepts de la physique quantique.
La science comme expérience sensible
Le cœur du projet d’exposition repose sur une analogie audacieuse : comparer la superposition quantique à la pluralité des souvenirs. « Un objet quantique peut exister, avant toute mesure, dans plusieurs états à la fois. Mais dès que nous le mesurons, il va se figer dans un état. De même, le souvenir n’est jamais univoque, chaque fois qu’elle le convoque, la mémoire le réassemble, le reconstruit », décrit Aurore Young. Un souvenir pouvant revêtir plusieurs formes selon le point de vue adopté, l’installation principale de l’exposition propose ainsi un dîner de famille, recomposé à partir de photographies anciennes. Caroline Delétoille en a tiré plusieurs peintures représentant la même scène sous des aspects différents, inspirées d’archives photographiques issues du musée Nicéphore-Niépce de Chalon-sur-Saône. Le visiteur est invité à reconstituer mentalement la totalité du souvenir, « comme on reconstruit un état quantique par tomographie », c’est-à-dire par l’agrégation de multiples mesures partielles. Ce geste d’analogie, précis et limité, rend palpable l’essence probabiliste de la mécanique quantique, sans la réduire à une image simpliste.
Consciente des mésinterprétations possibles, l’équipe a tenu à poser des garde-fous. « Nous ne voulions pas que les visiteurs pensent que la mémoire fonctionne réellement de manière quantique », insiste Aurore Young. La physique quantique est un domaine d’une extrême rigueur, et ses concepts, bien que parfois poétiques, obéissent à des lois mathématiques précises. Toute tentative d’analogie doit en assumer les limites. L’ambition n’est donc pas de réduire l’un à l’autre, mais de rendre sensible une intuition mathématique par une image familière. Ce projet est aussi l’occasion d’un déplacement par lequel l’art entre dans le laboratoire. Caroline Delétoille a mené plusieurs résidences, notamment au Collège de France et dans un laboratoire de Vancouver, pour « peindre la science » en train de se faire. Ce geste est rare, car, comme se souvient Aurore Young, « peu d’artistes ont représenté des laboratoires de physique quantique. Il y a pourtant une vraie beauté de la recherche ». Ce qui se joue ici est moins la restitution fidèle d’un univers technique que l’intuition esthétique de formes émergentes : nuages électroniques, superpositions d’états, réseaux d’atomes piégés par la lumière. Ainsi, des couvertures de survie – utilisées dans son laboratoire pour stabiliser les températures des lasers en occultant les fenêtres – deviennent matière picturale. Le laboratoire n’est plus simplement un lieu de production de savoir, mais un espace symbolique, traversé de questions esthétiques et existentielles.