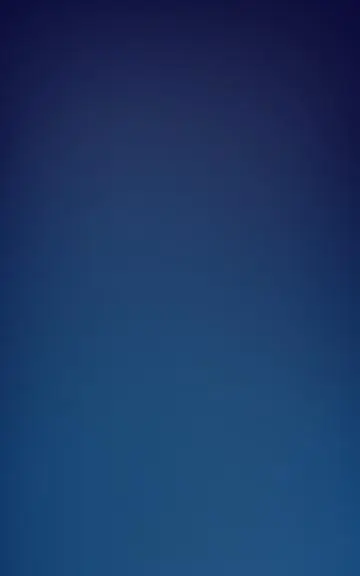Présentation
Il y a, dans le langage et dans la pensée, des mécanismes dédiés visant à assurer la représentation de soi. Dans le langage il y a la première personne, gouvernée par la convention selon laquelle « je » s'emploie pour faire référence à soi-même. Dans la pensée il n'y a pas de convention ou de règle, mais un concept de soi assimilable à un « dossier mental » spécifique dont la fonction, le rôle dans l’économie cognitive, est d’emmagasiner les informations dont le sujet dispose sur lui-même.
La représentation de soi est-elle d'abord et avant tout linguistique, comme le pense Benveniste ? Dans ce cours, je soutiens au contraire que la première personne linguistique présuppose la première personne mentale. Pour appliquer la règle selon laquelle « je » sert à se désigner soi-même, un utilisateur de « je » doit se représenter l'individu auquel il fait référence comme étant lui-même ; il doit donc disposer déjà du concept de soi.
Cette théorie se heurte à une objection de circularité qui rappelle beaucoup l'objection qu'elle-même fait à la théorie adverse (celle qui donne priorité à la première personne linguistique sur la première personne mentale). Ce qui permet de lever l'objection, c'est le fait que le concept de soi est lui-même ancré dans ce que les phénoménologues ont nommé la conscience de soi pré-réflexive. Celle-ci est abordée dans le cours à partir du cogito cartésien, auquel plusieurs séances sont consacrées, et du phénomène de l'immunité aux erreurs d'identification initialement repéré par Wittgenstein.