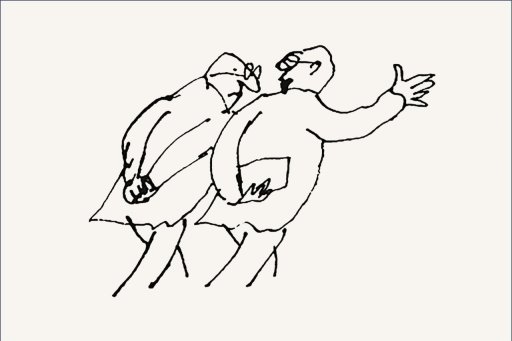Sensible depuis ses jeunes années à l’environnement montagneux, Sandra Lavorel est une spécialiste du milieu alpin. Pionnière de l’écologie fonctionnelle en France et dans le monde, son approche consiste à comprendre les fonctions des écosystèmes et les mécanismes sous-jacents aux changements qui les affectent. Au cœur de son travail, elle œuvre au dialogue entre la nature et les humains.
Elle est invitée à occuper pour l’année 2025-2026 la chaire Biodiversité et écosystèmes, qui bénéficie du soutien de la Fondation Jean-François de Clermont-Tonnerre.
Comment est né votre intérêt pour la science et pour l'écologie ?
Sandra Lavorel : Globalement, j’ai la chance d'avoir eu des enseignantes qui m’ont intéressée à la science dès l’école primaire et ensuite au collège. Toutes les disciplines me plaisaient beaucoup, néanmoins la biologie a fini par l’emporter, peut-être parce que j’allais beaucoup dans la nature, surtout pour une enfant qui grandissait en ville. Je le dois en partie à mes grands-parents, qui habitaient en montagne. En leur rendant visite, j’ai eu la possibilité de découvrir cet environnement magnifique, qui est très rapidement devenu mon milieu favori. Il ne m’a jamais vraiment quitté depuis, car j’en ai fait l’environnement de mes recherches en écologie fonctionnelle.
Au début de votre carrière, à quoi ressemblait le paysage scientifique de l'écologie fonctionnelle ?
La notion naissait à peine. L'idée, plutôt que de ne se pencher que sur de la description des écosystèmes, c’est de s'intéresser à leur fonctionnement. Pendant mon doctorat, la définition formelle de l'écologie fonctionnelle n’était pas encore publiée, c'était un domaine en phase d’émergence. Mais, une fois ma thèse en poche, j’ai effectué un postdoctorat pendant trois ans à l’Université nationale australienne où j’ai rejoint une équipe qui travaillait sur les effets de changements globaux sur les écosystèmes. C’est à ce moment-là que s’est affirmée cette composante écologique fonctionnelle. J'ai eu de la chance, car le directeur du laboratoire faisait partie des chercheurs qui commençaient à réfléchir à la modélisation de la diversité des plantes à l’échelle continentale et mondiale. C’est là qu'émergeait vraiment cette idée de « trait fonctionnel » – c’est-à-dire les caractéristiques qui déterminent le fonctionnement d’un organisme –, ce qui était commun avec les travaux des écophysiologistes. J’ai testé ces approches, que j’ai très vite eu envie de développer, une fois de retour en France. En 1996, on m’a généreusement donné les rênes d’un groupe de travail dans le cadre du programme « Global Change in Terrestrial Ecosystems », qui encourageait de jeunes chercheurs à se lancer dans la coordination internationale.
Après avoir travaillé sur un environnement méditerranéen, vous vous tournez vers la montagne. Quelles sont alors vos approches pour comprendre et suivre l’évolution des écosystèmes alpins ?
Je me suis d'abord intéressée à l'usage des sols, puis la dimension climatique est arrivée un peu plus tard. J'ai d’abord découvert – dans la pratique, car cela commençait à être connu dans la littérature – qu'un écosystème, à tout moment donné, est régi par un déterminisme double. D'une part, par son histoire d'usage, et de l'autre, par l'usage actuel qui en est fait. On ne peut donc pas se défaire de l'historique d'un sol, si l’on veut en comprendre les conséquences des usages actuels et futurs. C'est un peu comme une empreinte, qui se perpétue dans les écosystèmes. Par exemple, si l’on prend une prairie de fauche avec un historique de culture, elle n'aura pas du tout la même écologie qu'une prairie de fauche qui a toujours été fauchée, sans labour du sol. Ensuite, j’ai commencé à m’intéresser à la composante climatique. Le principe des expérimentations de changement climatique, c’est que l’on aimerait bien savoir ce qui va se passer à l’avenir. Plus qu’observer des effets d’un changement, on veut en comprendre les mécanismes. On a commencé par des expériences de « sècheresse » ; on intercepte la pluie et on arrose nos écosystèmes avec des quantités d’eau contrôlées. Puis, dans le cadre du réchauffement, je me suis inscrite dans un réseau mondial d’une douzaine de sites qui utilisent en environnement alpin un protocole similaire à ceux déjà très utilisés dans le milieu arctique. Il s’agit de petites serres en plexiglas qui permettent de simuler sur une petite zone les conditions de ce réchauffement ; grâce à elles, on obtient une hausse de 2°C de l’air et du sol. Cela nous place précisément dans les conditions du fameux scénario à +2°C prédit par les modèles actuels. Le seul biais, c’est que le phénomène est quasiment instantané, sous ces serres, donc il nous manque la période de transition. Nous travaillons sur deux sites, respectivement à 1 800 mètres et 2 400 mètres d’altitude, dotés de températures et de végétations naturellement différentes. Ce qui nous intéresse alors, c’est de déterminer si le changement que l’on provoque génère ou non des effets, et pourquoi.
Vous vous intéressez aux services que les écosystèmes rendent aux sociétés humaines. Quels sont-ils et comment observez-vous l’impact qu’a sur eux le changement climatique ?
Les services écosystémiques, ce sont les bénéfices que les humains tirent des écosystèmes et de leur biodiversité. On les distingue en trois catégories. D’abord, les services dits matériels, donc ce qui est récoltable : l’agriculture, les denrées sauvages, le bois et l'eau, par exemple. Ensuite – et c’est la catégorie la plus nombreuse – ce sont toutes les fonctions de régulation, dans lesquelles on compte trois sous-ensembles. Il y a la régulation du climat par la capture de CO2, ou l'émission de méthane par certains sols et écosystèmes ; la régulation biotique, avec les pollinisateurs et les prédateurs des ravageurs des cultures. Mais il ne faut pas oublier la régulation des risques ; une forêt qui stabilise des pentes et régule les avalanches et les chutes de blocs, la végétation riveraine qui régule les crues, le cycle de l'eau, et la chaleur, en particulier en ville. Enfin, on a les services non matériels qui englobent toutes les fonctions d'activités récréatives, d'inspiration artistique, de relations spirituelles et religieuses à la nature. Nous essayons d'avoir des indicateurs mesurables de chacun de ces services. Certains sont absolus, par exemple, pour mesurer la pollinisation, on peut compter le nombre de pollinisateurs sur les plantes selon la situation dans laquelle on se trouve en relation avec l’usage des sols et le changement climatique. S’il fait plus ou moins chaud, est-ce que l’on observe plus ou moins de pollinisateurs ? Sont-ce les mêmes ? Puis, d’autres indicateurs sont en partie subjectifs, puisqu’ils proviennent du point de vue des humains qui reçoivent les bénéfices des écosystèmes. Typiquement, pour la beauté d'un paysage ou les activités récréatives qu’on y pratique, on procède par enquête pour déterminer les caractéristiques que le public juge favorables ou défavorables. En tant que chercheurs, cela nous permet d’accéder à des informations parfois contre-intuitives.
Vos recherches mêlent donc sciences humaines et sciences de la nature. Comment cette intersection s’est-elle développée dans votre travail ?
Cela demande de longues années. Il faut rencontrer les bonnes personnes, établir avec elles une relation de confiance et développer des intérêts partagés. En tant qu’écologues, on ne peut pas aller voir des sociologues et exiger qu’ils travaillent sur nos écosystèmes et les problématiques et notions que nous déclarons. Il faut trouver un intérêt commun, ce qui implique de collaborer avec différentes disciplines ; non seulement des sociologues mais aussi des géographes et des anthropologues, selon les situations et les questionnements. La clé, c'est de passer du temps ensemble à se comprendre, à se familiariser aux problématiques les uns des autres, et d’avoir un vocabulaire commun. C’est le propre de toute démarche interdisciplinaire, et il y a aussi une partie d'apprentissage. Par exemple, en tant qu’écologue, j’ai appris comment les entretiens sont réalisés en sciences humaines, comment ils sont analysés. Dans notre domaine, on utilise beaucoup les méthodes participatives, à savoir de faire entrer les acteurs des territoires dans les processus de recherche. L’approche élémentaire, c’est de leur demander, avec des méthodes standardisées, comment ils perçoivent un écosystème ou un changement. Mais les sciences de l'environnement sont de plus en plus développées sur des approches transdisciplinaires ; on fait maintenant participer les acteurs à la construction des questions de recherche. Par exemple, s’accorder sur quel sujet nous allons expérimenter. Je travaille actuellement sur une expérimentation dans les prairies de montagne où l’on croise un traitement de régulation de l'eau dans le sol et un traitement de restauration de la composition après des perturbations par de petits rongeurs, comme les campagnols. Nous avons formalisé cette expérimentation avec un dispositif scientifique ; la question provient des préoccupations majeures des acteurs du territoire où l’on travaille.
Quels sont ces acteurs ? Et quels sont les enjeux de vos collaborations avec eux ?
Nous travaillons à plusieurs échelles. Localement, avec des agriculteurs, des habitants, ou encore des professionnels du tourisme. À des échelles plus larges, nous collaborons également avec des institutions au niveau territorial, comme la métropole de Grenoble, ou encore des départements, les chambres d'agriculture, et même jusqu’au niveau gouvernemental. L’enjeu du dialogue avec tous ces acteurs est celui d’une sensibilisation à double sens. Nous allons à la rencontre du public et des acteurs locaux pour présenter en termes accessibles la nature de nos recherches. C’est une part importante de notre philosophie de travail. Puis, dans l'autre sens, ce type de recherche demande d'être à l'écoute des acteurs publics, de leurs connaissances et de leurs perceptions.
Vous accédez cette année à la chaire annuelle Biodiversité et écosystèmes du Collège de France. Que vous inspire cette accession et quelles en sont vos attentes ?
Je suis vraiment très honorée d’être admise au sein de la grande institution qu’est le Collège de France. Cela me réjouit de pouvoir parler d'écologie fonctionnelle au large public qui est visé par le Collège, parce que c’est une sous-discipline assez méconnue, encore aujourd’hui. On en connaît peut-être certains éléments au sein du public, cependant, c’est un champ très large et je veux profiter de cette occasion pour emmener les auditeurs de mes cours et conférences jusqu’aux interfaces frontalières de ce domaine. En effet, il est dommage que certaines personnes pensent que l'écologie fonctionnelle s'arrête à l'écosystème. Je veux en montrer toutes les autres dimensions, et notamment l’aspect humain et social. C'est important d’un point de vue pédagogique, ainsi qu’en termes de communication générale. L’écologie ne se résume pas simplement à observer tel organisme ou à mesurer telle activité. C’est aussi, et d’autant plus de nos jours, prendre en compte le retour des écosystèmes vers les humains.
Propos recueillis par William Rowe-Pirra, journaliste scientifique