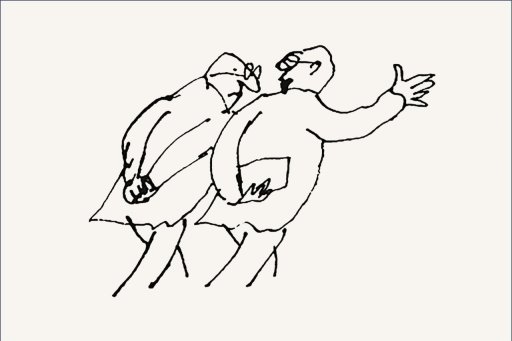À la fois chimiste du vivant et écologue, Claude Grison abat les cloisons entre les disciplines. Ses travaux sur les plantes capables de bioconcentrer des polluants métalliques et organiques sont valorisés dans une logique de chimie durable, et permettent de restaurer des écosystèmes extrêmement dégradés tout en recyclant des métaux polluants, comme le manganèse ou le palladium, en écocatalyseurs.
Elle est invitée pour l’année 2025-2026 sur la chaire annuelle Avenir Commun Durable, qui bénéficie du soutien de la Fondation du Collège de France et de ses grands mécènes la Fondation Covéa et TotalEnergies.
Comment est né votre intérêt pour la science, et notamment la chimie, dans un premier temps ?
Claude Grison : J’ai un esprit naturellement curieux, qui m’a attirée vers la science en général, autant la géographie que la chimie, ou la philosophie que l'écologie. Ce qui m’intéresse, c’est la cohérence globale de la science, qui me permet de répondre à des questions extrêmement variées. Je préfère l’interdisciplinarité à la fragmentation des connaissances, donc j’ai eu du mal à choisir une discipline dans mon cursus. J’ai opté pour la chimie du vivant – terme que je préfère à celui de chimie organique –, car c’est une discipline frontière ; un non-choix, en somme. Dans ce domaine, on s’intéresse forcément à d’autres champs, comme la biologie, l'écologie. C'est une question d'échelle, mais on étudie les mêmes êtres vivants, et l’on a besoin d'outils physiques, eux-mêmes très liés aux mathématiques. Nos questionnements de chercheurs sont aussi intrinsèquement liés à des notions de philosophie, comme la prise de recul et la remise en question. Enfin, comme j'aime bien que mon travail soit utile, je m'intéresse à l'économie.
Après de premiers travaux sur la résistance bactérienne, vous orientez finalement vos recherches vers l’écologie, qu’est-ce qui a motivé cette transition ?
Après être devenue professeure, en 1995, j’ai été envoyée par le CNRS pour codiriger le Laboratoire de chimie organique biomoléculaire à l’université de Montpellier en 2003, où l’environnement scientifique est très différent du contexte nancéien d’où je venais. J’y ai découvert des forces scientifiques importantes dans le milieu de l'écologie. Là, vers 2008, dans le cadre de mes enseignements, quatre jeunes étudiantes m’ont demandé de l'aide sur un sujet qu’elles préparaient pour un concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs. Elles avaient choisi une question très nouvelle à l'époque : peut-on dépolluer avec des plantes ? Je n’y connaissais pas grand-chose, mais leur enthousiasme m’a convaincue, alors je me suis renseignée, j’ai épluché la littérature scientifique et nous avons travaillé ensemble sur la question. J’ai alors découvert l’existence d’une plante fascinante, le tabouret bleu (Noccaea caerulescens), étudiée depuis plusieurs années par l’écologue José Escarré. Celle-ci parvenait à se développer sur un site minier très pollué près de Montpellier, hostile à tous les autres végétaux – une véritable anomalie de la nature. Mieux, elle extrayait un élément métallique du sol, le zinc, et le stockait dans ses feuilles, comme pour s’en protéger ! J’y ai vu une réponse de la nature absolument géniale, et une alternative bien plus intéressante que les méthodes habituelles de dépollution des sols, comme l’excavation des terres ou les traitements chimiques. Or, le Pôle interministériel de prospection et d’anticipation des mutations économiques alertait déjà à l’époque sur l’état critique des ressources minérales, comme le zinc. Pour moi, cela a été un déclic. Nous avions sous les yeux une plante qui rendait un double service en extrayant une ressource minérale précieuse tout en restaurant les sols, pour permettre un retour à la biodiversité d’origine du site. Et la matière végétale qui en résulte n’est pas un déchet contaminé, mais une ressource naturelle exploitable.
Quelles applications imaginez-vous dès lors ?
J'ai réfléchi à un modèle économique crédible. Quelle surface de culture serait nécessaire pour obtenir un bénéfice économique qui permettrait de soutenir le développement de cette plante à grande échelle ? L’utiliser pour produire du zinc métallique n'avait aucun sens, car il aurait fallu des surfaces démesurées. C’est là que ma casquette de chimiste a fait la différence. En chimie, on utilise des catalyseurs qui servent à démarrer, accélérer, ou rendre plus intéressantes certaines réactions, impliquant des millions de molécules. Or, les catalyseurs au zinc sont de ce registre ; on peut utiliser très peu de zinc pour produire beaucoup de molécules. C’est pour poursuivre cette idée que j’ai intégré le Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier, où j’étais la seule chimiste ! Au bout d’un an, les premiers résultats tombaient. Mes feuilles de tabouret bleu, chargées en zinc, catalysaient une réaction chimique. Peu de temps après, j’allais en Nouvelle-Calédonie, point chaud de la biodiversité mondiale, afin de restaurer des sites miniers à l’aide de plantes locales. Je parle de restauration, car la notion de dépollution totale est assez naïve. Notre objectif n’est pas d’éradiquer tout polluant ; nous voulons rendre ses droits à la nature et rétablir la biodiversité originelle des sites pollués. Ces terrains, à l’époque déserts et hostiles, ont aujourd’hui reverdi : les jeunes plants que nous y avons installés, il y a plus de dix ans, mesurent aujourd’hui près de deux mètres. Et de nombreuses plantes locales sont réapparues. Par ailleurs, les catalyseurs obtenus sont parfois même plus performants que ceux issus de la métallurgie, et nous avons trouvé des structures de catalyseur complètement nouvelles. Puis, je me suis intéressée à la pollution de l'eau. En se servant de certaines plantes aquatiques envahissantes, qui sont un vrai fléau pour la biodiversité, et en les réduisant à l’état de poudre, on s’est rendu compte que l’on pouvait récupérer dans l’eau des métaux stratégiques. Le palladium, par exemple, qui fait défaut en France et dont le producteur mondial principal est la Russie. Or, c’est un métal indispensable dans l’automobile ou en électronique, mais aussi pour la production d’un médicament sur trois, en chimie pharmaceutique. Aujourd'hui, je développe la récolte massive de ces plantes envahissantes en suivant un protocole écologique qui nous permet de mesurer le bénéfice que l'on apporte à la biodiversité et à la production de ressources précieuses. Ce sont des modes de raisonnement qui ne sont pas traditionnels, mais il faut remettre en cause les réflexes d’une économie linéaire, et développer la logique d’une vraie chimie durable où les enjeux économiques, écologiques, sociaux et environnementaux sont en harmonie.
En quoi cette chimie durable diffère-t-elle de ce que l’on appelle la chimie verte ?
La chimie verte s'appuie sur des principes visant à diminuer l'impact des procédés chimiques. C'est utile, mais insuffisant. La chimie durable m’inspire davantage, car elle s'appuie sur les piliers du développement durable pour résoudre des problèmes environnementaux anciens, actuels et futurs. La chimie verte ne cherche pas à résoudre ces problèmes, mais à éviter ceux qui pourraient survenir. Alors, comment résoudre les problèmes déjà identifiés ? Du reste, elle omet l’aspect socio-économique des solutions envisagées. Sans cet aspect, vos solutions peuvent être les plus vertueuses ou les plus performantes possibles, personne ne les développera.
En tant que seule chimiste dans un laboratoire d’écologues, comment l’interdisciplinarité vous a-t-elle affectée ?
Le directeur de ce laboratoire, qui était mathématicien, estimait que certaines activités de l’écologie manquaient justement de chimie. J’ai apporté aux écologues une compétence qui leur manquait et eux m’ont instruite de connaissances qui me faisaient défaut. Face à une plante capable d’accumuler en elle des polluants, l’écologue se demande : « pourquoi ? » et le chimiste : « comment ? » Deux questions tout aussi importantes, dont les réponses complémentaires m’ont permis de développer les divers projets de restauration écologique que j’ai menés. Tout au long de cette collaboration, je me suis affranchie des cloisons artificielles qui sont parfois dressées entre les disciplines scientifiques. Le CNRS m'a alors proposé de créer le Laboratoire de chimie bio-inspirée et d'innovation écologique que je dirige actuellement, avec cette interdisciplinarité qui va jusqu'à la direction. Les gens ne savent plus comment me qualifier. Suis-je chimiste ou écologue ? Je m’estime écochimiste. Aujourd’hui, on ne peut concevoir l’une sans l’autre. L’écologie est le point de départ de l'innovation, et la chimie lui apporte une dimension économique, qui va à son tour soutenir les solutions écologiques.
Quelles ont été les difficultés majeures que vous avez rencontrées pendant la poursuite de ce projet ?
Les préjugés – comme celui qui veut que la chimie et l’écologie seraient incompatibles – qui viennent d'une culture monodisciplinaire très ancrée. Or, reconcevoir les choses différemment est extrêmement difficile : certaines personnes demeurent très hostiles à ces idées nouvelles, par principe, et il est impossible d’avoir une conversation avec elles. Cet obstacle s’est manifesté à tous les niveaux : financements, publications, grand public… Heureusement, j'ai aussi rencontré des personnes extraordinaires, qui m'ont beaucoup aidée. Du reste, ma motivation réside dans l'utilité de mes recherches. Je veux être une chercheuse citoyenne ; je veux avancer, et prouver par les résultats qu’une démarche différente s'appuyant sur le développement durable est possible. Je me réjouis d’ailleurs de constater chez les jeunes chimistes et écologues un engouement absolument exceptionnel.
Vous accédez en 2025 à la chaire Avenir Commun Durable du Collège de France. Que représente-t-elle pour vous et qu’en attendez-vous ?
Cette nomination est une fierté pour ce que je défends, c'est-à-dire cette interdisciplinarité entre écologie et chimie, et j’en suis très reconnaissante. Aujourd'hui, la recherche me prend un temps considérable, mais la chaire va me permettre d’échanger avec le public et de partager mon travail ; un vrai plaisir quand on est professeure. Et le Collège de France est très ouvert, accueillant tous types de curieux de science, peu importe leur formation. Je me réjouis de tous ces conférences et dialogues qui m’attendent, comme la journée d’échanges avec des lycéens que j’ai organisée et à laquelle je tiens beaucoup. Je leur ai lancé un défi : la chimie peut-elle être écologique ? On va réfléchir à cette question ensemble. Un autre aspect intéressant est que je peux inviter des personnes d’horizons variés qui développent des idées complémentaires aux miennes. Nous allons discuter ensemble avec ces invités et le public, sur des questions de fond, de résultats techniques, mais aussi sur toute la philosophie et la réflexion qui les sous-tendent. Et cette occasion est absolument formidable.
Propos recueillis par William Rowe-Pirra, journaliste scientifique