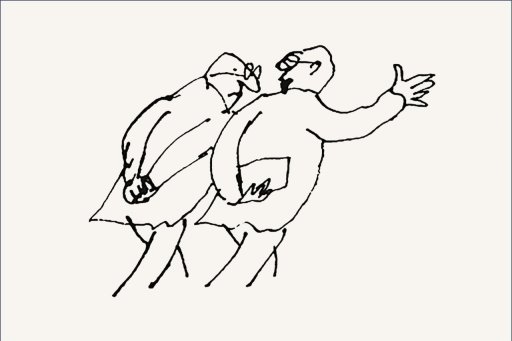Directrice de recherche à l’Inserm et investigatrice principale de l’étude NutriNet-Santé, Mathilde Touvier s’intéresse aux relations de causalité entre nutrition et santé humaine, avec une approche holistique et multidisciplinaire. Les travaux de son équipe participent à l’élaboration des recommandations du Programme national nutrition santé.
Pour l’année 2022-2023, elle est invitée sur la chaire annuelle Santé publique du Collège de France, chaire créée en partenariat avec Santé publique France.
Vos travaux portent sur les relations entre la nutrition et la santé. Comment en êtes-vous venue à vous intéresser à ce sujet ?
Mathilde Touvier : J'ai toujours été attirée par le domaine de la santé humaine. À l’aube de mes études, j’ai pensé suivre un cursus de médecine, mais la prévention via la recherche m’intéressait davantage que le soin clinique. Alors, j’ai intégré l'AgroParisTech, dont la spécialisation en santé humaine est portée sur la nutrition. Puis, j’ai réalisé un crochet par la Californie, à l'université Davis, où j’ai effectué un stage avec des expériences en laboratoire sur des modèles de rongeurs, portant sur les voies métaboliques impliquées dans l’étiologie[1] de l’obésité et une hormone, la leptine. Cette parenthèse m’a permis de comprendre que je voulais travailler sur la prévention des pathologies, mais avec un champ disciplinaire qui ne soit pas fixé sur une voie métabolique particulière ; avec une approche un peu plus holistique de l'individu en somme, tenant compte des facteurs de son environnement, de son histoire personnelle et familiale, de ses comportements qui influencent le risque de maladies chroniques. Ces aspects d'épidémiologie et de santé publique ne m'étaient pas très clairs au départ, mais me sont apparus à la suite de ce stage très orienté sur la recherche expérimentale et le travail en paillasse. Lors de ma dernière année d'école d'ingénieurs, j'ai eu la chance de réaliser mon projet d'ingénieur avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (l'Anses), ce qui m'a donné envie de compléter mon parcours par un master (DEA à l'époque) en santé publique. À partir de là, le double cursus nutrition, santé publique et épidémiologie a pris tout son sens, et je ne regrette pas du tout ce choix, car il me correspond complètement par son impact sur la santé humaine et la prévention, avec des aspects à la fois culturels, socioéconomiques et socioécologiques ; la nutrition se situant au carrefour de tous ces facteurs.
Vous dirigez l’étude NutriNet-Santé qui, depuis 2009, vise à évaluer le lien entre les habitudes alimentaires et la santé. Comment les données sont-elles collectées et étudiées ?
L'idée, c'est de collecter via Internet un très grand nombre d'informations sur l’exposition nutritionnelle – donc tout ce qui est lié à l'alimentation, au mode de vie et aux rythmes alimentaires, mais aussi sur l'activité physique et la sédentarité, des notions prises en compte dans le domaine global de la nutrition. Nous avons un ensemble d'outils qui fait de cette étude, au niveau international, l'une des plus poussées et détaillées sur la caractérisation de ces habitudes alimentaires, avec certains comportements émergents, et d'autres, plus traditionnels. Nous travaillons donc avec ce qu'on appelle « une cohorte ». Nous suivons un groupe de participants dans le temps, et certains vont développer des pathologies comme des cancers, du diabète ou des maladies cardiovasculaires, tandis que d’autres vont prendre ou perdre du poids, par exemple. Il se passe beaucoup de choses au niveau de la santé, qu'on mesure à l'aide d'un questionnaire régulier et d'un comité médical, lequel, lorsqu'un événement particulier est détecté, vérifie les compléments d'information, comme les comptes rendus d'hospitalisation, pour valider tous ces événements de santé. Nos données sont également liées à celles des bases médico-administratives de l’assurance maladie. Nous collectons aussi beaucoup d'informations sur des éléments qui font partie du mode de vie sans toucher directement à l'alimentation, mais qui peuvent jouer un rôle de facteur de confusion dans les relations entre santé et nutrition, tabagisme, exposition solaire, médicaments... L’évaluation de ces profils est très complète, avec des données collectées de manière répétée au fil du suivi. Cela nous permet vraiment d'étudier les associations entre un profil alimentaire – avec ses éventuelles expositions nutritionnelles à certains additifs ou contaminants – et un risque plus ou moins fort de développer telle ou telle pathologie. Cette grande cohorte réunit à ce jour plus de cent soixante-treize mille participants de quinze ans et plus, et est dite ouverte, c'est-à-dire que nous avons recruté une bonne partie de l'échantillon en 2009, au lancement de l’étude, mais nous recrutons encore de nouveaux volontaires qui nous rejoignent au fil de l'eau chaque année.