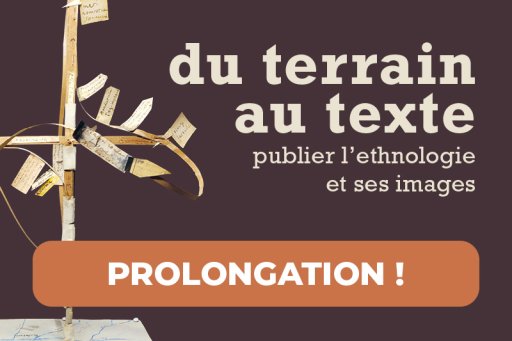Reconduit pour un troisième mandat d’administrateur du Collège de France le 1er septembre 2025, Thomas Römer revient sur son parcours académique et le fonctionnement de cette institution unique au monde créée sous François Ier. Il évoque aussi les défis qu’elle se prépare à relever dans les années à venir.
En 2007, vous devenez professeur du Collège de France. Comment s’est déroulé votre recrutement ?
Thomas Römer : J’étais professeur à Lausanne lorsque l’on m’a appelé. Mon interlocuteur, professeur du Collège de France, m’a dit : « Nous réfléchissons à une chaire autour de la Bible hébraïque. Est-ce que vous seriez intéressé par un poste ? » À partir de là, il m’a fallu rédiger une sorte de curriculum intitulé « Titres et travaux ». Ce document comporte une cinquantaine de pages au sein desquelles il faut résumer vos recherches, vos publications, votre vision de la discipline et aussi comment vous imaginez la façon dont elle devrait être enseignée. Ensuite, il faut se rendre à Paris pour rencontrer chaque professeur et professeure en personne, même si l’on n’est même pas encore candidat, puisqu’aucune chaire n’est alors créée. L’élection du professeur par l’assemblée (ndlr : conseil d’administration et conseil académique du Collège de France) ne se fait que plus tard, lorsque la chaire a fait l’objet d’un avis de vacance, publié par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. L’assemblée se réunit trois fois par an, les derniers dimanches des mois de mars, de juin et de novembre. Le vote est à bulletin secret. Ensuite, l’administrateur transmet au ministre la proposition de candidat résultant de l’élection par l’assemblée. Mais ce n’est qu’une fois que le décret de nomination est pris par le président de la République et publié au Journal officiel que l’on devient professeur du Collège de France.
En tant que chercheur, vous vous présentez comme « bibliste ». Qu’évoque pour vous ce titre et pourquoi compte-t-il autant à vos yeux ?
Selon moi, un bibliste enseigne la Bible d'une manière laïque, en l’appréhendant de façon historique et en la replaçant dans son contexte culturel. Ma démarche est de proposer un discours sur la Bible qui se veut le plus scientifique et le plus objectif possible. Pour y parvenir, je m’appuie sur un travail pluridisciplinaire qui emprunte à la philologie, à l’histoire ou encore à l’archéologie.
Jusqu'à aujourd'hui, dans le christianisme et surtout dans la tradition protestante, il existe une vision d’une « immédiateté » de la parole biblique qui serait directement inspirée des paroles de Dieu. Or, prendre de la distance historique comme nous le faisons pour n'importe quel texte de l'Antiquité, c’est aussi une manière de protéger la Bible contre certaines utilisations abusives.
Vous êtes devenu administrateur du Collège de France en 2019 et vous venez de commencer votre troisième mandat à ce poste. En quoi celui-ci consiste-t-il ?
Le titre d’administrateur du Collège de France est un peu trompeur. En réalité, mon rôle consiste à conduire la politique de l’établissement, à présider l'assemblée des professeurs, les différentes commissions internes et à représenter l'institution, que ce soit dans les médias ou auprès des autorités officielles.
C’est un poste qui requiert d’être fédérateur et à l'écoute, même si chacun habite le rôle différemment. Personnellement, je ne recherche pas toujours un consensus, mais je souhaite que tout le monde puisse s'exprimer et que la parole ne soit pas censurée. Je pense que l’administrateur du Collège de France doit s’attacher, en permanence, à soutenir la collégialité dans les orientations et les décisions prises. J’aime ce poste, car il me permet d’avoir une vision différente de l'institution, de voir ce qui se passe dans les coulisses et de contribuer à développer encore son rayonnement. On le relaye peu, mais le Collège de France, outre nos quarante-trois professeurs, rassemble environ mille personnes réparties sur trois sites, en tenant compte des unités de recherche que nous accueillons et qui contribuent à l’effort de recherche global de l’institution. Il faut souvent anticiper la charge de travail : l’administrateur continue en effet à donner ses cours et à faire ses recherches, il n’a pas de dérogation par rapport à ses pairs.
Je suis le premier étranger à présider cette institution et c'est aussi une certaine fierté. J’aime l’idée d’un accès sans condition au savoir, transmis à toutes et à tous, sans discrimination et sans frais, d’autant plus que, dans le contexte actuel, la vérité scientifique est un pilier qu'il faut défendre.
Quelles qualités doit posséder selon vous un bon candidat pour un poste de professeur au Collège de France ?
Un bon candidat, c'est d'abord une très bonne chercheuse ou un très bon chercheur. Il faut à cet égard un profil qui soit impliqué dans la recherche académique pour pouvoir puiser dans suffisamment de contenus, et assurer un nouveau cours chaque année. En effet, nous ne répétons pas les mêmes cours d’année en année, contrairement à ce qui se fait à l’université. Notez, et cela peut parfois avoir des incidences sur le choix des futurs professeurs ou professeures, qu’il faut pouvoir donner ses cours en français. Notez aussi qu’il n'y a pas de succession au niveau des chaires, celles-ci ne sont pas reconduites automatiquement. Nous allons plutôt chercher un profil, une personne qui pour nous fait consensus dans un domaine scientifique qui nous semble important. Il y a une très grande liberté au niveau de la définition des chaires. Il peut y avoir des moments où nous ne voyons pas vraiment qui pourrait en occuper une déjà existante, donc nous nous orientons vers un autre profil et une autre discipline. Ensuite, nous réalisons une enquête discrète en écrivant à certains collègues afin d’obtenir des propositions de candidats possibles. En tenant compte de ces avis, mais en toute liberté, nous contactons enfin la personne qui nous semble la plus appropriée pour voir si elle serait intéressée.
En revanche, il n’y a pas de prérequis de popularité. Il y a des cours qui n’attirent qu’une poignée d’auditeurs et d’auditrices, mais cela fait aussi partie de la volonté de notre institution de couvrir l’ensemble de la connaissance. Cela peut par exemple être le cas dans des disciplines moins faciles d’accès, comme les mathématiques fondamentales. Pourtant, pour rester dans le domaine des mathématiques, parmi le public restreint d’une professeure ou d’un professeur, on trouvera parfois de futurs titulaires d’une médaille Fields.
En 2030, le Collège de France fêtera ses cinq cents ans. Qu’espérez-vous pour cette échéance ?
Lors de sa fondation, le Collège de France était déjà un collège ouvert sur l’extérieur : parmi les premiers « lecteurs royaux » (ndlr : nom donné aux professeurs à la création de l’établissement), il y avait des savants qui venaient d'Italie et de Wallonie pour dispenser leurs cours. Dans le même esprit, ce serait magnifique pour nos cinq cents ans d’avoir une sorte de fédération de collèges au niveau européen. Le Collège Belgique, par exemple, a été fondé en 2009 avec notre parrainage. Et récemment, une convention de partenariat a été signée avec l’université Humboldt de Berlin, l’une des plus grandes universités allemandes.
L’arrivée des cinq cents ans est aussi l’occasion de nous projeter sur ce que serait le Collège de France dans les cent ans à venir. Quels sont les grands enjeux ? De quelle manière peut-on mieux faire passer le savoir ? Est-ce qu'il faut en rester à un format de cours d'une heure ? Comment diffuser encore plus les vidéos et podcasts des cours ? Est-ce qu'il faut enseigner physiquement en dehors de Paris ? L'idée commence à émerger qu’en 2030 nous pourrions donner nos cours davantage en région. La question de la parité se pose aussi ; nous voulons tendre vers plus de femmes dans les effectifs professoraux, par exemple en demandant à nos collègues chargés de proposer des candidats à une nouvelle chaire qu’ils présentent systématiquement un homme et une femme. Il s’agit de façon générale d’être sensibles à ces questions de parité, à tous les niveaux de l’établissement. Nous souhaiterions aussi engager de jeunes chercheuses et chercheurs qui pourraient être, d'une certaine manière, le Collège de demain, et leur donner la possibilité de venir travailler et de donner des cours chez nous pour une durée de deux ou trois ans. Je pense que notre force c’est cette excellence sur le plan académique, mais aussi notre faculté à nous adapter, en dépit des crises et des bouleversements.
Bien entendu, l’un de nos défis reste celui du soutien financier de la recherche et de la diffusion de ses résultats. Des mécènes, de grands donateurs, des fondations nous soutiennent, mais il nous faudra renforcer encore le mécénat et trouver d’autres sources de financements. En France, ce n’est pas dans les mœurs, car nous vivons dans un pays où l’État soutient largement les établissements publics. Demander de l’argent n’est pas très répandu dans le milieu académique, contrairement aux pays anglo-saxons où les grandes universités américaines reposent pour beaucoup sur des endowment funds et le recours à des mécènes. C’est un travail de longue haleine et je m’y attacherai à nouveau, pendant les prochaines années, avec toute l’énergie nécessaire.
Propos recueillis par Emmanuelle Picaud, journaliste scientifique