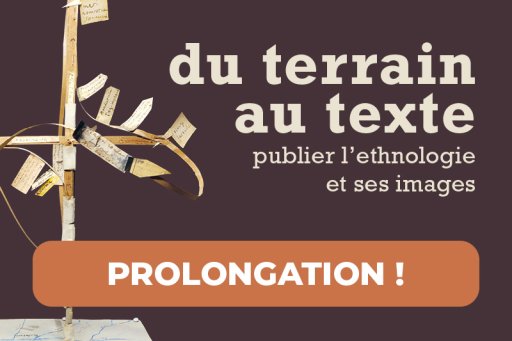Le traitement des exilés est la grande question morale et un enjeu politique majeur de notre temps
Anthropologue, sociologue et médecin, Didier Fassin interroge la valeur de la vie humaine et son traitement inégal dans le monde contemporain. Il a multiplié les enquêtes sur trois continents autour de la santé, de la justice, du châtiment et de l'exil.
Invité en 2019 sur la chaire annuelle Santé publique du Collège de France, chaire créée en partenariat avec l'agence nationale Santé publique France, il devient, cette année, titulaire de la chaire Questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines.
Vous avez une formation initiale de médecin. Comment êtes-vous venu à l’anthropologie et à l’étude des conditions de vie de paysans équatoriens, de citadins sud-africains et de détenus français ?
Didier Fassin : Jeune médecin, j’ai eu l’opportunité de travailler en Inde, et j’y ai découvert deux choses qui ont joué un rôle déterminant dans la suite de ma trajectoire : d’une part, la grande pauvreté, qui m’a ouvert les yeux sur les inégalités sociales ; d’autre part, les différences culturelles, qui m’ont conduit à penser la question de l’altérité. Mais je demeurais frustré de ma pratique clinique. Seul médecin d’une institution dédiée au traitement de malades indigents, je les soignais, mais une fois qu’ils allaient mieux, on les remettait à la rue. C’est ce qui m’a d’abord orienté vers la santé publique, discipline qui agit en amont de la maladie pour l’éviter, afin de ne pas avoir à la guérir et que j’ai pratiquée en Tunisie, en développant des programmes de dépistage et de prévention de ce qui était la première cause de mortalité chez les jeunes : les cardiopathies dues au rhumatisme articulaire aigu.
Mais ni la médecine clinique ni la santé publique ne permettaient d’appréhender l’expérience des gens, qui ils étaient, ce qu’ils faisaient, et les mécanismes qui produisaient les disparités devant la vie et devant la mort. Dans les sciences sociales, ce qui m'a passionné – et qui me passionne toujours – c'est la compréhension en profondeur d’histoires individuelles et de mondes sociaux très différents, qu’il s’agisse de femmes indiennes dans les campagnes d’Équateur ou de malades du sida dans les townships d’Afrique du Sud, de policiers d’une brigade anticriminalité ou de personnes détenues dans une maison d’arrêt, en France. À chaque fois, j'ai le souci de comprendre qui ils sont, la manière dont ils pensent, la façon dont ils agissent et justifient leurs actions, les environnements sociaux dans lesquels ils s’inscrivent.

Un thème récurrent revient dans votre travail, celui de la vie humaine. Vous l’abordez dans ses dimensions politiques, économiques, morales, ou encore historiques. Qu’avez-vous appris en étudiant la vie sous ces multiples dimensions ?
Ce thème est au croisement de mes deux métiers. Les médecins s’intéressent à la vie biologique, au corps et à ses dysfonctionnements ; les anthropologues, à la vie biographique, aux histoires des personnes et aux récits qu’elles en font. La réflexion que j’ai conduite dans mes travaux, en particulier dans le livre La Vie. Mode d’emploi critique, se situe à l’intersection des deux pour appréhender la vie comme fait biologique et événement biographique. Ce que le philosophe et médecin Georges Canguilhem exprimait à travers les deux participes du verbe vivre : le vivant et le vécu.
Ce qui me semble la contradiction morale et politique la plus remarquable des sociétés contemporaines concerne précisément cette tension entre le biologique et le biographique. D’une part, la vie, au sens d’être en vie, est le bien le plus précieux non seulement des individus, mais de la société dans son ensemble, notamment, mais pas seulement, dans les sociétés occidentales. Des moyens considérables sont dépensés pour la protéger et la prolonger. Mais d’autre part, les vies, au sens de vivre, sont évaluées en fonction du statut, de la richesse, de la nationalité, avec en France des différences d’espérance de vie de treize années à la naissance entre les cinq pour cent les plus pauvres et les cinq pour cent les plus aisés.
Caricaturalement, aux États-Unis, certains peuvent défendre la vie sous la forme élémentaire de l’embryon et du fœtus, tout en se montrant indifférents à l’égard des vies des membres des minorités ethnoraciales qui sont abattus par les forces de l’ordre ou des exilés qui demandent l’asile pour fuir les dangers mortels courus dans leur pays. Tout se passe comme si nous établissions une différence entre la vie, au singulier, comme réalité abstraite, et les vies, au pluriel, comme fait concret.
Cette contradiction a été mise en lumière avec la pandémie de Covid. D’un côté, les gouvernements ont été capables d’interrompre presque toutes les activités humaines, notamment économiques, et de suspendre nombre de droits et de libertés, dans le cadre parfois d’états d’urgence, et ceci pour une seule raison, à savoir préserver à tout prix la vie, essentiellement celle des personnes âgées. Mais d’un autre côté, l’infection a révélé de manière flagrante les inégalités devant la maladie et devant la mort, le taux de décès des Noirs et des Indiens étant trois fois plus élevé que celui des personnes blanches aux États-Unis, tandis qu’en Île-de-France l’excès de décès dans les villes pauvres était lui aussi trois fois supérieur à celui des villes riches. Double dévoilement, donc : l’extrême valorisation de la vie humaine et les grandes disparités de sa distribution effective.
Faut-il considérer que la vision progressiste de la vie humaine a été une forme de régression ?
Non, mais les avancées, marquées par un allongement de l’espérance de vie moyenne, ce dont il faut se réjouir, ont été très inégalement réparties. Et du reste, la focalisation sur la seule dimension quantitative de la durée de vie, donc biologique, risque de faire négliger la dimension qualitative de bonne vie, donc biographique. Il nous faut nous intéresser aux disparités dans la quantité de vie, mais aussi dans la qualité de la vie, laquelle ne consiste pas seulement à vivre en bonne santé, ce à quoi s’intéressent les épidémiologistes et les économistes, mais aussi à vivre dans des conditions dignes, à bénéficier de la considération de la société, à se réaliser comme personne. C’est ce que j’avais essayé de montrer dans ma leçon inaugurale « L’inégalité des vies ».
Aujourd’hui, le débat sur les retraites porte précisément sur cette question. Ce qui est en jeu, avec le recul de l’âge de départ à la retraite et l’augmentation du nombre d’annuités pour une pension à taux plein, c’est l’injustice qu’il y a à imposer les mêmes règles à toutes et à tous, indépendamment de ce qu’ont été les conditions de travail et du nombre d’années qui restent à vivre en moyenne, en fonction des catégories sociales et des métiers exercés, avec tout juste quelques accommodements à la marge. Les réponses budgétaires, au demeurant contestées par la plupart des experts, qu’on apporte aux revendications passent à côté de cette demande d’équité, qui est aussi ce que le philosophe Axel Honneth appelle « une demande de reconnaissance ».

Vous vous êtes intéressé aux enjeux moraux et aux discours qui justifient l’acceptation du bien et du mal par les sociétés. Qu’est-ce qui vous a poussé à vous poser ces questions abordées à maintes reprises par les philosophes ?
Les philosophes réfléchissent depuis plus de deux mille ans à la morale, et du reste, cette réflexion s’est enrichie et diversifiée au cours du dernier siècle. Les juristes également s’intéressent à la morale, et la codifient à travers des principes et des lois. D’une manière générale, les uns et les autres pensent en termes normatifs. Ils se demandent ce qu’est une vie bonne, sur quels fondements on peut dire qu’une action est bonne ou mauvaise, juste ou injuste, et peuvent même prescrire des règles en fonction de leur analyse.
Les historiens, anthropologues ou sociologues ne se demandent pas comment les choses devraient être, mais comment elles sont en réalité. Pour ce faire, ils étudient des sociétés, des groupes, des institutions, des individus et s’attachent à comprendre comment ils évaluent concrètement ce qui est moral et ce qui ne l’est pas et comment ils appliquent cette évaluation à leurs actions.
Pour en donner un exemple, sur la question du châtiment et de la peine, les philosophes et les juristes se demandent notamment comment on justifie de punir quelqu’un qui a commis une infraction. Les uns, héritiers d’Emmanuel Kant, disent qu’un acte délictueux doit être puni simplement pour ce qu’il est, et si possible de façon équivalente à l’infraction : dans ce cas, le juge applique un barème de quantum de peines. Les autres, s’inspirant de Jeremy Bentham, affirment qu’on doit punir uniquement pour autant que les effets produits soient bénéfiques à la société : dans ce cas, le juge se demande si la sanction réduit ou non le risque de récidive. L’historien va plutôt se demander comment la réponse à une infraction a évolué dans le temps ; l’anthropologue, quelles sont les manières de sanctionner dans différentes sociétés ; le sociologue, dans quelle mesure la justification de la peine varie en fonction de la classe sociale de la personne à punir. Leur travail est donc descriptif, analytique et critique.
Une autre distinction importante entre la philosophie et les sciences sociales, du moins telles que je les conçois, c’est que je considère qu’il n’y a pas de morale en soi. Elle peut certes exister dans une doctrine ou un catéchisme, mais dans la société, il y a des questions morales qui émergent, souvent en lien avec des enjeux politiques – d’où le titre de ma chaire. La réalité de la pratique pénale – ce qu’est une infraction, comment il faut la punir, à qui l’appliquer – repose sur des présupposés moraux, mais dépend aussi du contexte politique.
C’est ce qui explique le moment punitif que traverse la France depuis plusieurs décennies et qui se renforce encore aujourd’hui quand la plupart des pays européens cheminent en sens inverse. Il me semble donc essentiel d’étudier ensemble questions morales et enjeux politiques. Et de le faire dans une perspective critique, comme je m’y suis employé avec une équipe d’une douzaine de jeunes chercheuses et chercheurs dans un projet soutenu par le Conseil européen de la recherche.
Votre leçon inaugurale au Collège de France portera sur les sciences sociales en temps de crise. Comment justement penser les crises, alors que nous en vivons plusieurs en ce moment (environnementale, sanitaire, économique) ?
L'étymologie grecque nous apprend que le substantif krisis a donné à la fois « crise » et « critique ». L’historien Reinhart Koselleck a d’ailleurs pu lier la crise de l’Ancien Régime à l’émergence de la pensée critique des Lumières, les deux termes prenant à cette époque le sens que nous leur connaissons. Je pense donc que le rôle des sciences sociales dans un moment de crise, c'est justement de revendiquer leur savoir critique, y compris en interrogeant ce que nous entendons par « crise ».
Par exemple, qu'est-ce qui explique que certaines situations sont décrites comme des crises alors qu'elles ne reposent sur aucun élément objectif, telle la supposée crise des migrants dont on continue à entendre parler en Europe alors même que les statistiques la démentent ? À l'inverse, nous faisons face à des situations critiques qui ne donnent pas lieu à l’évocation d’une crise, comme c’est le cas de l’inflation carcérale en France ou aux États-Unis. Revendiquer ce savoir critique, c’est donc se demander pourquoi le terme « crise » est employé ou non dans les discours et quelles actions en découlent.

Votre cours, cette année, portera sur la question des exilés et de la frontière. En quoi l’anthropologie peut-elle nous aider à traiter ce sujet sensible ?
Le titre du cours est « Les épreuves de la frontière ». Je crois que le traitement des exilés est la grande question morale et un enjeu politique majeur de notre temps. Mes leçons s’efforcent d’éclairer cette situation en montrant comment les frontières se sont transformées au cours des dernières décennies, étendues, renforcées, externalisées, internalisées, et comment les exilés, dont beaucoup fuient toutes sortes de menaces dans leur pays, se retrouvent prisonniers de politiques hostiles qui exposent leurs vies et les réduisent à des conditions dégradantes en Europe, aux États-Unis, au Maghreb et au Moyen-Orient.
Il n’en a pas toujours été ainsi. Le cas des demandeurs d’asile est révélateur. Plus de neuf sur dix obtenaient un statut de réfugié à la fin des années 1970. Le regard porté sur les boat people en mer de Chine était alors plein de sollicitude. Un quart de siècle plus tard, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides accordait l’asile moins d’une fois sur dix. Les milliers d’hommes et de femmes se noyant dans la Méditerranée chaque année ne recevaient plus la même attention. Pour comprendre cette évolution, j’ai proposé le concept d’économie morale, c’est-à-dire la production, la circulation et l’appropriation de valeurs et d’émotions. S’agissant des demandeurs d’asile, en quelques décennies, la société française est passée d’une économie morale de la compassion à une économie morale de la suspicion.
Le cours s’appuie sur une enquête conduite depuis cinq ans avec Anne-Claire Defossez à la frontière entre l’Italie et la France, où nous rencontrons des exilés, des volontaires, des policiers, des représentants des pouvoirs publics. L’ethnographie est en effet partie intégrante de toutes mes recherches. Mais j’élargis ma perspective pour prendre en considération d’autres régions du monde. Au fond, il s’agit de savoir s’il est moralement acceptable et politiquement défendable de traiter de manière hostile et souvent indigne des personnes venant de pays du Sud avec lesquels notre histoire, souvent coloniale ou impériale, a pourtant partie liée.

Propos recueillis par Emmanuelle Picaud