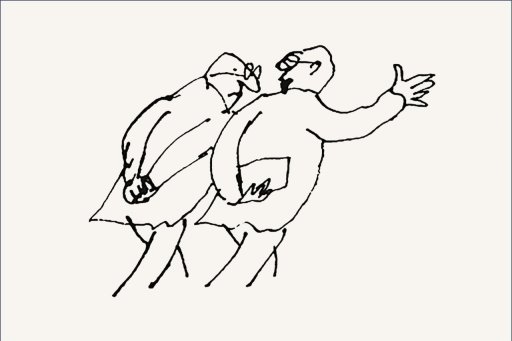Isabelle Ratié est spécialiste de philosophie indienne. Elle édite des textes sanskrits à partir de manuscrits et les traduit. Elle retrace ainsi l’histoire de différents courants de pensée encore peu connus, et analyse la complexité de leurs rapports.
En 2025, elle devient titulaire de la chaire Histoire des systèmes de pensée de l’Inde au Collège de France.
Vos recherches portent aujourd’hui sur la philosophie indienne, mais vous avez commencé votre carrière par l’étude de la philosophie occidentale. Comment expliquer ce changement de trajectoire, alors que votre chemin semblait tout tracé ?
Isabelle Ratié : Effectivement, j’ai d’abord fait des études tout ce qu’il y a de plus classiques ! Passionnée notamment par la philosophie grecque, j’ai obtenu un DEA et allais entamer un doctorat dans ce domaine. Fraîchement agrégée, j’ai commencé une carrière de professeur de philosophie au lycée… Cependant, un jour, je suis tombée sur un livre de Guy Bugault, L'Inde pense-t-elle ?. Cette lecture a été un choc pour moi. J’ai pris conscience de l’existence d’une philosophie indienne, riche et passionnante. On m’avait pourtant répété depuis la Terminale que la philosophie était l’apanage de l’Occident : elle était née en Grèce autour du Ve siècle avant Jésus-Christ et s'était développée en Europe ; ses frontières étaient merveilleusement tracées ! J’ai ressenti une sorte de rage contre moi-même : comment avais-je pu refuser d’interroger ce poncif, alors que la philosophie est justement un exercice critique de la raison ?
J’ai donc voulu explorer cet univers. Très vite, j’ai découvert que les bons ouvrages de synthèse étaient rares, et qu’il existait peu de traductions de textes philosophiques indiens dans des langues modernes. Cela m'a contrainte à me mettre intensivement à l’apprentissage du sanskrit, et à changer radicalement l’orientation de mes études.
Pourquoi la philosophie indienne est-elle si méconnue en Occident ?
La pensée indienne est, en effet, souvent résumée au silence de la méditation et à l'expérience mystique… Cela s’explique par le faible nombre d’ouvrages et de traductions disponibles, mais pas seulement. Il y a un vrai déni de l’Inde philosophique. Quand l'Europe a découvert la pensée indienne, elle a d’abord été fascinée, puis a eu un mouvement de recul horrifié. Durant la fin du XIXe siècle et une bonne partie du XXe siècle, on a considéré, souvent avec mépris, que la pensée indienne était uniquement d’ordre religieux et ne relevait en aucun cas de la philosophie – cette réflexion fondée exclusivement sur la raison et l’expérience. En réalité, la pensée indienne s’est développée en des systèmes qui ne ressemblent pas à ceux de l’Europe, et dont certains sont sans aucun doute philosophiques. La rencontre avec cette pensée bousculait cependant la manière dont les Occidentaux avaient tracé les frontières entre la philosophie et la religion. Quand ils ont découvert le bouddhisme, par exemple, ils ont eu du mal à accepter que des notions aussi fondamentales pour eux que l’âme ou l’existence d’un dieu créateur puissent être mises en question au sein même d’une religion…
Comment s’articulent les domaines du religieux et du philosophique dans la pensée indienne ?
Ces deux réalités sont distinctes et pourtant fonctionnent ensemble. La sphère religieuse a pour noyau la reconnaissance d'un ensemble d’Écritures, de paroles faisant autorité par principe. C’est dans la reconnaissance de ce caractère sacré de certains textes que se cristallisent les identités religieuses. Au premier millénaire de notre ère, les brahmanes orthodoxes, par exemple, reconnaissent l’autorité du Veda, toutefois les courants dits śivaïtes acceptent, à côté ou à la place de l’autorité védique, celle de textes qui sont dits émaner du dieu Śiva ou d'une divinité associée… Il existe dans l’Inde médiévale une grande diversité de courants religieux : le brahmanisme orthodoxe, des mouvements śivaïtes, bouddhiques, jaïns, vishnouites… Là se trouve cependant le grand paradoxe de l’Inde, car ce foisonnement religieux a abouti à une compétition qui faisait rage dans les cours royales. Les mouvements religieux s’y affrontaient pour obtenir les faveurs des rois ou des dignitaires. Pour prendre part à ces joutes oratoires et démontrer la supériorité de ses dogmes, chaque représentant a dû laisser de côté ses Écritures. En effet, personne ne reconnaissait celle de son adversaire ! La philosophie indienne est donc cet espace neutre dans lequel on a mis entre parenthèses l’argument d’autorité et où l’on s'est mis à discuter en se fondant sur la perception commune et le raisonnement inférentiel – car ce sont les seules armes universellement reconnues. Les philosophes ont aussi écrit un très grand nombre de traités, qui, dans leur structure, sont imprégnés par cette rhétorique du débat. Si certains textes religieux sont très anciens (certaines parties du Veda ont dû être composées autour de 1200 avant notre ère), la philosophie en tant que telle s’est développée en Inde plus tardivement, tout au long du premier et du deuxième millénaire de notre ère, avec une vitalité particulière autour du milieu du premier millénaire.
Vos travaux ont la spécificité et le mérite de ne pas se concentrer sur une seule école philosophique. Vous en étudiez plusieurs, ce qui vous permet d’analyser leurs liens…
Il existe un certain cloisonnement dans l’indianisme. Dans nos études, on se spécialise généralement dans un courant religieux ou philosophique et l’on s’y tient… La spécialisation est une tendance naturelle et indispensable de toute science, mais, quand on cherche à comprendre les systèmes de pensée de l'Inde, il faut passer outre ces frontières, car ces écoles n'ont cessé de se transformer au contact les unes des autres. J’ai compris cela dès le début de mes travaux de thèse, grâce aux auteurs śivaïtes Utpaladeva et Abhinavagupta dont j’étudiais les œuvres. Afin de démontrer la supériorité de leurs idées, ils ont dû s’intéresser à celles des autres… Et s’en sont trouvés changés. Par exemple, ils mentionnent beaucoup leur rival bouddhiste Dharmakīrti : ils ne cessent d’expliquer sa pensée pour la critiquer, bien qu’ils en soient passionnés. Ils adoptent des pans entiers de sa logique et de son épistémologie (sa manière de définir les différents types de raisonnement inférentiel, par exemple) et empruntent ses arguments pour prouver que le monde n’existe pas à l’extérieur de la conscience. Néanmoins, ils transforment aussi ces arguments en profondeur : ce qui produit les phénomènes variés dont nous avons conscience n’est plus chez les śivaïtes, comme chez Dharmakīrti, une sorte de mécanisme inconscient dans une série impersonnelle d’événements cognitifs instantanés, mais la liberté créatrice qui est l’essence même de toute conscience.
Plutôt que de décrire chaque école de pensée séparément, de manière statique et cloisonnée, il vaut donc la peine d’étudier les thèmes sur lesquels se sont affrontés différents penseurs. On découvre ainsi la philosophie indienne en train de se faire par les discussions qui se sont développées autour d’une controverse – sur la nature du soi, d’autrui, du langage… Je compte poursuivre au Collège de France cette démarche, déjà adoptée, avec Vincent Eltschinger dans notre ouvrage Qu’est-ce que la philosophie indienne ?.
Vous évoquiez la rareté des traductions fiables de textes sanskrits. Quels sont les enjeux de votre travail de philologue sur ces sources manuscrites ?
L’Inde a longtemps eu une importante tradition manuscrite : au fil des siècles, des scribes, qui étaient souvent aussi des savants, ont constamment recopié et même annoté des textes appartenant à divers genres, y compris philosophiques. Ces annotations érudites sont une source merveilleuse (et encore très peu explorée) pour l’étude de l’histoire intellectuelle de l’Inde. Cependant, la transmission manuscrite, même lorsqu’elle est effectuée par de grands savants, conduit inévitablement avec le temps à une accumulation d’erreurs – ce que l’on appelle la corruption des manuscrits. Nous comparons donc toutes les sources qui sont encore accessibles aujourd'hui pour tenter de retrouver le texte originel – ou plutôt, car ce n’est qu’un idéal, de nous en approcher autant que possible. Beaucoup de manuscrits nous sont parvenus, bien que nombre aient disparu, notamment à cause du climat. Ils peuvent aussi avoir été mal catalogués, ou être difficiles d’accès pour diverses raisons. Il ne nous reste parfois plus que quelques fragments d’un texte, une citation dans un autre manuscrit, par un autre penseur, dans une marge… Il arrive aussi que le texte sanskrit soit introuvable, mais qu’une traduction ancienne soit préservée, en tibétain, par exemple. L’avènement de la photographie numérique a constitué un progrès important et permis de sauver beaucoup de manuscrits extraordinaires ! Il reste beaucoup à découvrir, et surtout, un énorme travail d’édition doit encore être accompli.
Que représente pour vous cette nomination au Collège de France ?
J’ai encore du mal à réaliser. Je ne l’avais jamais envisagée, d'abord parce qu'il n'y avait jamais eu de femme sur cette chaire. J’ai toujours voulu faire une carrière dans le domaine de la recherche, pourtant jamais il ne me serait venu à l'esprit de briguer cette place-là… Alors que, pour certains des messieurs de cette institution, c'était un rêve de petit garçon, un destin possible dès l'enfance. Je me sens aussi très privilégiée, au point de ressentir de la culpabilité vis-à-vis de mes collègues de l’université. Je sais à quel point leurs conditions sont difficiles : les enseignants-chercheurs sont aujourd'hui accablés par des tâches administratives qui leur volent le temps qu’ils devraient pouvoir consacrer à la recherche.
Le Collège de France a créé en 1814 la première chaire de sanskrit en Europe. Elle a parfois changé d’intitulé (pour inclure d’autres langues indiennes, ou porter davantage sur l’histoire que sur les langues), et a été occupée par des savants extraordinaires, tels qu’Eugène Burnouf, Sylvain Lévi ou Jean Filliozat. C’est très intimidant de succéder à tous ces grands chercheurs. Je vais passer le reste de ma carrière à essayer de mériter cet honneur effrayant que l'on me fait ! Je suis aussi très heureuse pour ma discipline, qui voit cette chaire indianiste revivre : son dernier occupant, Gérard Fussman, l’avait quittée en 2011. Je la vois comme un moyen de fédérer les indianistes. Je souhaite créer des occasions de rencontre pour faire dialoguer ceux qui travaillent sur l’Inde, quel que soit leur domaine et d’où qu’ils viennent. Cela promet de très beaux échanges.
Propos recueillis par Salomé Tissolong, journaliste